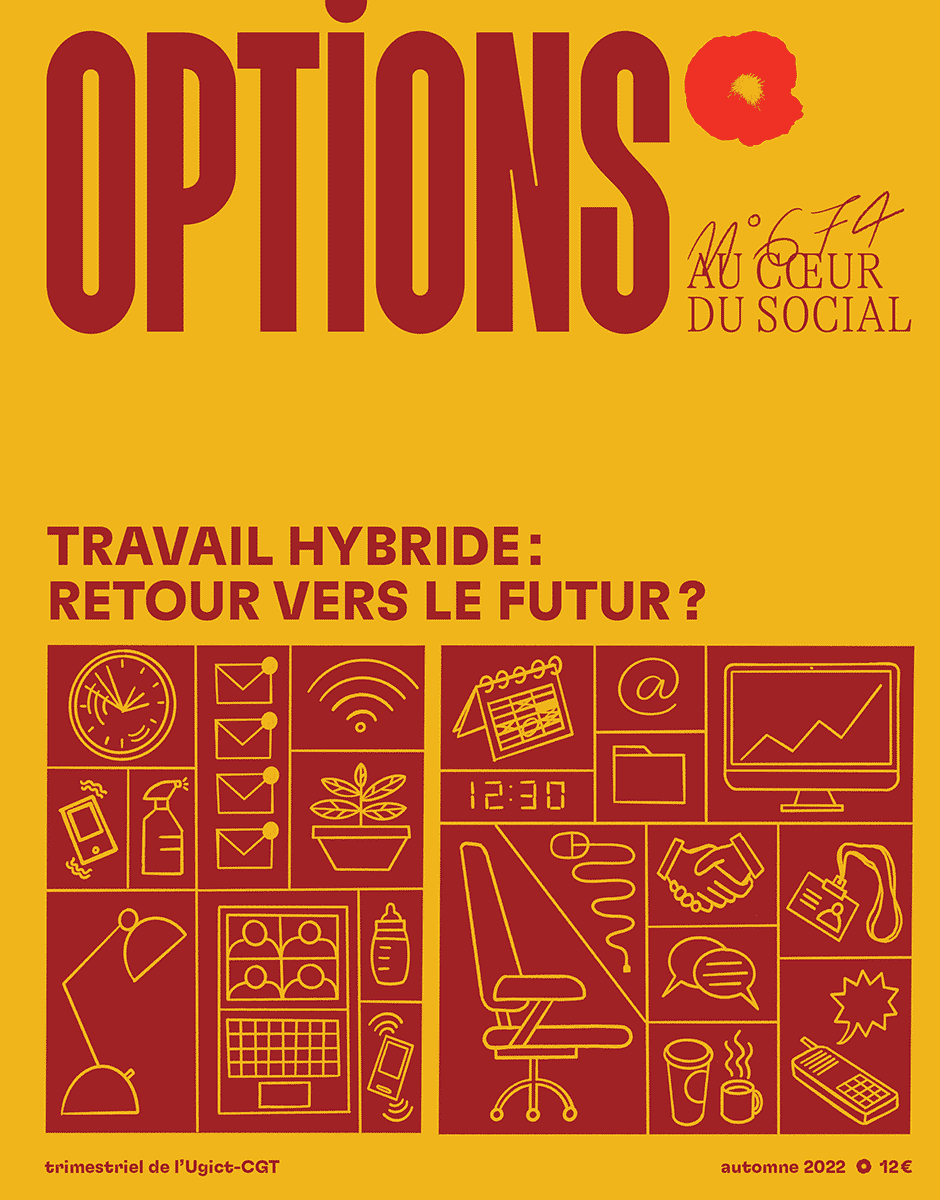Table ronde – L’égalité femmes-hommes bouscule l’ordre social
21 mars 2018Avec : Mylène Casimir, référente femmes-mixité pour la fédération Cgt Banques et Assurances ; Ophélie Labelle, membre de la commission […]
Avec :
- Mylène Casimir, référente femmes-mixité pour la fédération Cgt Banques et Assurances ;
- Ophélie Labelle, membre de la commission exécutive de la fédération Santé-Action sociale, responsable du collectif Femmes-mixité ;
- Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-Cgt, élue à la commission exécutive confédérale et pilote du collectif Femmes-mixité ;
- Pierre Tartakowsky, Options.
– Options : La libération de la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles est spectaculaire et profonde. Ce mouvement d’opinion est-il aussi un mouvement social, articulé aux enjeux de libération des individus au travail ?
– Ophélie Labelle : Les violences touchent tous les milieux socioprofessionnels, ceux de la santé et de l’action sociale compris. Dans la plupart des cas, nos interpellations des directions ou des pouvoirs publics sur ces affaires restaient sans suite. L’affaire Weinstein a modifié l’écoute, autant que la parole, même si les réponses restent loin du compte sur l’accompagnement des victimes et la mise en place de plans de prévention au sein des établissements de santé comme vis-à-vis des violences intrafamiliales, qui ont des conséquences sur le travail.
De fait, une collègue victime de violences risque de se mettre en retrait vis-à-vis de son équipe, du travail et la hiérarchie, si elle n’est pas saisie des problèmes, risque d’en tirer des conclusions négatives : manque de disponibilité, d’esprit d’initiative… Avec, bien entendu, des conséquences sur sa carrière.
Tout ce qui institutionnalise une « infériorisation naturelle » des femmes est gros de violences potentielles et fait système. L’écoute de telle ou telle victime permet d’ailleurs de vérifier que chaque affaire renvoie presque systématiquement à un contexte collectif.
À ce titre, on peut dire que la violence induit inégalité et discrimination et réciproquement : tout ce qui institutionnalise l’idée d’une « infériorisation naturelle » des femmes est gros de violences potentielles et fait système. L’écoute de telle ou telle victime permet d’ailleurs de vérifier que, si chaque affaire est unique, elle renvoie presque systématiquement à un contexte collectif. Il s’agit donc de dévoiler cette dimension collective, de s’en emparer pour mettre en place un plan de prévention avec le Chsct.
C’est d’autant plus nécessaire dans des milieux de travail où les hiérarchies professionnelles croisent des dimensions de genre et des mécanismes de subordinations qui impliquent – même si c’est un non-dit – une domination, au sens large. Les médecins sont plus facilement des hommes et les infirmières, des femmes. Cette cartographie genrée de la domination se retrouve dans les salaires, les responsabilités, les carrières…
Lorsque nos syndicats n’arrivent pas à prendre ces questions en charge, ils interpellent directement les personnes concernées et les accompagnent. Autrement dit, ils s’engagent sans attendre d’être devenus des spécialistes, en sachant qu’il y aura besoin d’aide, d’expériences, mais que l’essentiel est de manifester présence et solidarité. Et nous sommes toujours accueillis comme légitimes, y compris parfois par les directions qui sont plutôt contentes d’avoir des interlocuteurs face à des situations toujours compliquées.

Ophélie Labelle 
Mylène Casimir 
Sophie Binet
– Sophie Binet : Le mouvement actuel part du vécu individuel – et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup – pour devenir un vécu collectif. À ce titre, il s’agit bien d’un « mouvement social » accompagné de nouvelles solidarités, de nouveaux réflexes qu’on peut vérifier par exemple dans les transports en commun. Le scandale Weinstein a fait rupture en grande partie parce que les femmes concernées étaient de véritables idoles planétaires. On s’identifie plus facilement à une star hollywoodienne qu’à une femme agressée. C’est ce qui a permis que la honte change de camp. Ce mouvement dérange l’ordre établi. D’où la coalition d’oppositions hargneuses, de Causeur à Alain Finkielkraut, à laquelle il faut être attentifs car cette libération reste toute relative.
Parler, c’est toujours s’exposer, particulièrement au travail où les rapports de domination s’ajoutent aux rapports de subordination. Cela fait maintenant des années que nous travaillons à traiter ces enjeux en termes collectifs, des années que nous martelions les chiffres dans nos formations, dans nos interventions syndicales. Nous avons, en 2014-2015 tenu des assises sur les enjeux de l’égalité et édité un guide Cgt sur ce thème : Combattre les violences sexistes et sexuelles. À l’automne 2017, nous avons tenu de nouvelles assises, en nous appuyant sur une enquête en entreprise. Il s’agissait d’aider à sortir du tabou pour systématiser nos demandes d’un volet « violences » dans les accords égalité passés en entreprise. Ce à quoi les directions s’opposaient la plupart du temps. Nous avons également rappelé que, s’il y a un agresseur, il doit certes être sanctionné, mais qu’il revient d’abord à l’employeur de prendre des mesures préventives et de garantir un contexte de travail excluant la violence.
De fait, la remise en cause des violences sexistes et sexuelles percute les rapports sociaux, les clichés sexistes et les organisations du travail qui les structurent. Elle permet de réinterroger les rapports sociaux dans l’entreprise, les assignations sexistes qui évacuent le professionnalisme des femmes pour ne considérer que leurs seules apparences. Lorsqu’on nie le premier au bénéfice des secondes, on révèle l’existence d’une continuité toxique entre ce qui infériorise les femmes et ce qui peut les menacer. La violence sexiste et sexuelle surgit pour menacer les femmes et leur rappeler qu’elles n’ont pas à transgresser l’ordre établi.
– Options : Le président de la République s’est engagé à faire de l’égalité une grande cause nationale du quinquennat ; les ministres rivalisent de propositions… L’égalité femmes-hommes est-elle – enfin – en marche ?
– Mylène Casimir : Si elle marche, c’est à la façon d’un nourrisson : à quatre pattes et en zigzag… D’abord, même si le constat fait un peu mal, nous nous heurtons au poids des mentalités, des naturalisations, y compris bien entendu chez les femmes. Je pense à cette collègue qui me dit : « De toute façon, chez nous, les femmes sont majoritaires, alors on n’est pas concernées » ; ou à cette autre qui m’explique qu’elle n’a pas de désir de pouvoir et que, par conséquent, les discriminations de carrière ne la concernent pas… Ces mentalités ne sortent pas de nulle part. Elles constituent une intériorisation, une sorte d’adaptation aux réalités telles qu’elles sont, plutôt qu’un choix d’affrontement.
Les salariées subissent tout à la fois le poids des hiérarchies professionnelles qui sont, de fait, patriarcales, celui des tâches familiales, du fait que leur salaire reste considéré comme d’appoint et c’est cette masse qui structure les « mentalités individuelles ». Face à cette réalité-là, les accords d’entreprises, même s’ils sont nickel, ne suffisent pas, parce que l’enjeu n’est pas circonscrit aux murs de l’entreprise. Les revendications que l’on présente – de la prise en charge de la petite enfance à une égalité salariale réelle – pèsent dans le bon sens, mais c’est un travail de longue haleine avec les salariées aussi bien qu’avec les employeurs. Or, sur tous ces enjeux, les Rh campent sur le principe que tout est possible aux femmes à condition qu’elles le veuillent. Cette négation du plafond de verre revient d’ailleurs à faire porter aux femmes la responsabilité des inégalités qui les accablent.
– Mylène Casimir : Il est vrai que la parole et l’écoute se sont libérées, y compris en milieu de travail. Avant, on « savait » mais un peu « sans savoir » : ça se chuchotait, on en parlait avec gêne, comme s’il s’agissait d’un problème d’ordre privé. Aujourd’hui, les gens se sentent témoins, parlent, s’engagent. S’agit-il d’une mode, y a-t-il une part d’effets d’annonce ? C’est possible. Mais le fait de dire clairement de quoi on parle, et d’en dénoncer les effets, c’est déjà une avancée majeure. On sort des confusions un peu lourdes du genre « avec tout ça, on ne sait plus comment faire pour draguer ». Désolée, mais je ne suis pas inquiète pour ce qui est de la drague : l’amnésie n’est pas à l’ordre du jour.
Mais ce dont il est question ici n’a rien à voir avec la drague, la séduction ou un quelconque « esprit français ». Il s’agit de commentaires lourdingues, de présences physiques pénibles, d’attouchements inappropriés. Aucun désir partagé, aucune empathie joyeuse là-dedans. Le fait de « savoir de quoi on parle » – et on a organisé des formations pour cela – permet d’inscrire le sujet dans son contexte d’entreprise, d’en faire un truc collectif, à partager avec les collègues. Même si cela reste délicat à aborder ; beaucoup d’entre elles s’interrogent sur la légitimité du syndicat à se mêler d’affaires qui leur apparaissent « compliquées », relevant de l’intime… Nous leur faisons remarquer qu’une salariée dans cette situation va s’isoler, arriver en retard, devenir moins performante, moins concentrée, va avoir besoin d’aide. Si alors elle ne pouvait pas compter sur la solidarité syndicale, on se demanderait vraiment à quoi servirait le syndicat ?
– Sophie Binet : C’est un peu la rançon du succès. Le « retour du féminisme » militant, s’accompagne d’un « féminisme washing », un féminisme de com’, vidé de tout contenu, pire encore, mis au service de stratégies marketing, qu’il s’agisse de mode, de politique ou de consommation… Axa, L’Oréal et Emmanuel Macron sont experts en récupérations de ce type, qui ignorent la réalité et le poids des enjeux sociaux. À la Cgt, nous considérons que l’on ne peut pas dissocier rapports de sexes et rapports de classes, ne serait-ce que parce que les femmes sont majoritairement des salariées. Lorsqu’on développe d’un côté une politique qui s’attaque aux salariés on ne peut pas, de l’autre, prétendre défendre la cause des femmes.
Quand on remet en cause le caractère collectif de la rémunération dans la fonction publique pour accroître les primes et la part variable, on exacerbe automatiquement l’inégalité entre femmes et hommes. Lorsqu’on supprime des postes de fonctionnaires et qu’on remet en cause services publics et missions de services publics, on fait reculer un emploi qui est à 62 % féminin et on aboutit à reporter automatiquement sur les femmes la prise en charge des personnes âgées dépendantes, de la petite enfance, de l’éducation et de l’accès aux soins, au détriment de leur capacité à travailler, à assurer leur indépendance économique.
Emmanuel Macron vante l’égalité, mais il en a une vision élitiste. Il entend soutenir une « top féminisation », promouvoir des « têtes d’affiche » femmes chez les cadres dirigeants. Que des femmes réussissent, c’est bien, c’est excellent. Mais lorsque le Medef a installé une femme à sa tête, sa politique n’est pas pour autant devenue féministe ou égalitaire. La situation des femmes en temps partiel ou en emploi précaire ne s’est pas améliorée. C’est sur l’ensemble du champ social qu’il faut agir, à partir de politiques publiques qui structurent non pas des « réussites » mais une égalité de droits.
Une salariée victime de violences va s’isoler, arriver en retard, devenir moins performante, moins concentrée. Elle va avoir besoin d’aide. Si alors elle ne pouvait pas compter sur la solidarité syndicale, à quoi servirait le syndicat ?
– Ophélie Labelle : dans la fonction publique, on affronte le même type de discours. Théoriquement, le statut de la fonction publique exclut les inégalités. Dans les faits, elles pèsent lourd. Pour rappel, avec 62 % de femmes, on est à 19,2 % d’écart salarial entre femmes et hommes en équivalent temps plein. L’écart salarial monte à 21 % dans la fonction publique hospitalière, du fait de l’absence de reconnaissance des qualifications des métiers à prédominance féminine, et de l’absence de reconnaissance de la pénibilité, notamment chez les hospitaliers. Anecdote : les sages-femmes et les infirmières se sont vues supprimé la pénibilité alors qu’elle était reconnue aux infirmiers sapeurs-pompiers, corps majoritairement masculin…
L’État employeur devrait être exemplaire mais il n’y a rien sur la reconnaissance des qualifications, ni même pour des études sur la valeur des métiers, malgré des demandes réitérées de la Cgt. En revanche, nous avons beaucoup d’affichage sur la haute hiérarchie, sur des « primonominations », une communication qui « oublie » la majorité des emplois. Pour « celles qui en veulent » on fait miroiter une carrière possible, mais sur la base d’un modèle d’organisation du travail et des responsabilités qui reste masculiniste : une disponibilité de chaque instant, pas de temps pour la vie privée ou les enfants… Pour les autres femmes, on vante un modèle souple, celui du télétravail, avec retour au foyer et combinaison heureuse de trois journées de travail : salarié, domestique, maternel le cas échéant…
Bref, soit vous vous comportez « en hommes » soit vous agissez « en femmes »… Or nous ne voulons pas calquer un modèle toxique pour les hommes pour l’appliquer aux femmes : nous voulons dégager du temps pour que toutes et tous puissent vivre pleinement leur vie affective et personnelle.
Nous sommes bel et bien sur un sujet de conquête, qui lie profondément aspirations sociales et sociétales, et sur quoi nous avons tout à gagner. Nous pouvons nous appuyer sur un très fort sentiment d’injustice dans toute la société. C’est un levier puissant pour le syndicalisme.
– Options : Comment franchir une étape nouvelle dans les mobilisations en faveur de l’égalité femmes-hommes ?
– Mylène Casimir : Il faut poursuivre nos explications sur le front des mentalités en veillant particulièrement à ne pas nous laisser enfermer dans une mise en opposition artificielle entre femmes et hommes. Ce serait d’autant plus ridicule, que nous, les femmes, n’avons pas grand-chose. Alors, autant le valoriser, notamment les droits sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour obtenir qu’ils progressent.
Nous devrions davantage mettre en avant ce qui se fait dans d’autres pays. Je pense à l’Islande, ou l’égalité professionnelle se porte mieux qu’en France. Il y a enfin des progrès à accomplir au quotidien, des mentalités à faire évoluer – je pense aux congés parentaux que les hommes n’osent pas encore prendre ou ne veulent pas prendre par crainte de perdre de l’argent. Pour progresser sur les deux fronts, il y a besoin que nous, les salariées, on s’en occupe. Sachant que les autocensures dans ces domaines doivent beaucoup aux charges de travail, aux salaires inégaux entre la femme et l’homme.
– Ophélie Labelle : La grande question, c’est d’être en capacité de parler à tous et à toutes, sachant que personne n’est réductible au fait d’être « salarié » ou « ménagère » mais que chaque individu – femme ou homme – est traversé de préoccupations multiples, dans des champs très divers. Le syndicalisme assume beaucoup de préoccupations, de batailles, d’exigences, qui parfois rencontrent une sorte d’évidence de l’intérêt général. Dans la santé on connaît ça avec les mobilisations autour de la maternité, de l’hôpital, où les usagers convergent avec les salariés. L’égalité femmes-hommes est un peu du même ordre : on s’adresse là à l’ensemble de la société, au-delà des murs de l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée. Lorsque cette rencontre se produit, et c’est ce qui se passe avec les violences sexistes et sexuelles, cela peut aller loin.
– Sophie Binet : nous devons tous et toutes porter une grande attention au fait de ne pas laisser s’opérer une déconnexion des rapports de sexes et des rapports de classes. À cet égard, la Cgt peut, de par sa nature, éclairer le lien entre ces dimensions. Le risque est de voir s’installer en France le scénario catastrophe de l’élection présidentielle américaine : d’un côté, une candidate championne de la diversité et de l’égalité des sexes, mais aveugle aux rapports d’exploitation du travail ; de l’autre, un candidat sexiste et raciste qui se pose en défenseur de l’industrie, de l’emploi…
Nous devons également être vigilantes sur les campagnes de la droite radicalisée visant à rabougrir le mouvement à une sorte de guerre des sexes sur le mode : « Ce que les femmes vont prendre, les hommes vont le perdre. » On mesure les implications de cette logique en entreprise en matière de salaires par exemple. L’enjeu de l’émancipation des femmes, c’est une amélioration pour elles et pour les hommes, un progrès pour toutes et tous. Nous sommes bel et bien sur un sujet de conquête, qui lie profondément aspirations sociales et sociétales, et sur quoi nous avons tout à gagner.
Le gouvernement ne nous ménage pas, mais nous pouvons nous appuyer sur un très fort sentiment d’injustice dans toute la société. C’est un levier puissant pour le syndicalisme. On le mesure au fait que l’adresse au président de la République intitulée « Pour l’égalité professionnelle, nous voulons des actes » a été cosignée par la Cgt, la Cfdt, Fo, la Cfe-cgc, la Cftc, la Fsu, Solidaires et l’Unsa.