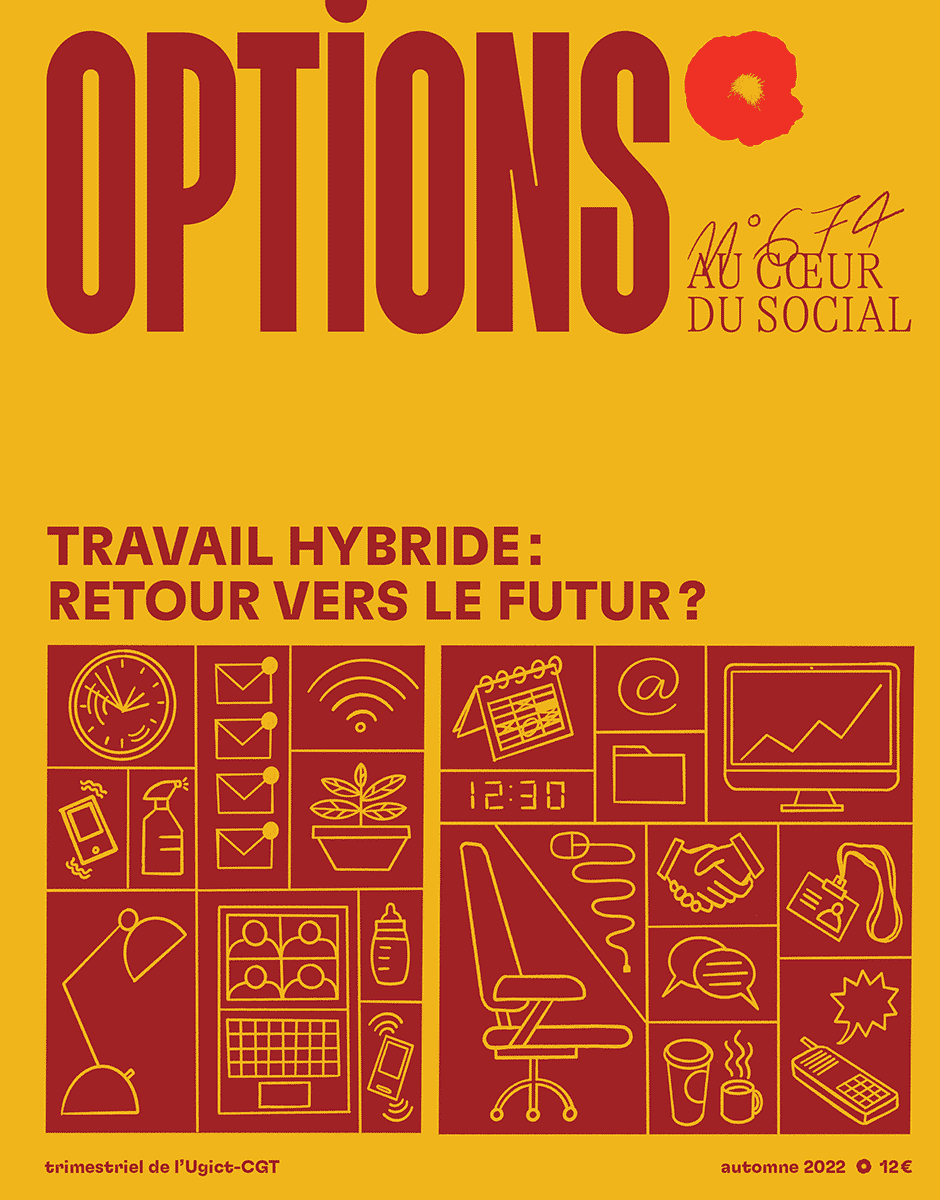Humanité : XXIe siècle, travail monde
23 octobre 2019Une conviction, une conviction puissante traverse cet ouvrage et lui confère, du début à la fin, souffle et passion : le […]

Une conviction, une conviction puissante traverse cet ouvrage et lui confère, du début à la fin, souffle et passion : le travail – dans son essence et non dans ses formes salariées ou serviles –, est fondateur de l’espèce humaine. Il est et fait l’être humain. À l’appui de cette conviction, l’ouvrage convoque l’anthropologue André Leroi-Gourhan pour nous rappeler que « l’humanité change un peu d’espèce à chaque fois qu’elle change à la fois d’outils et d’institutions », et la sociologue Simone Weil pour qui « c’est par le travail que la raison saisit le monde même, et s’empare de l’imagination folle ».
En peu de mots, l’essentiel est posé : l’humanité est une, mais ne se comprend que dans sa diversité, ses évolutions consécutives aux sauts technologiques, lesquels bouleversent les institutions qui en assument la représentation et l’expansion. Ce passage de l’imaginé au réel, à un concret mis en mouvement, ne peut s’opérer que par le travail, seul à pouvoir donner corps à nos images mentales. Pour Alain Supiot, la « fin du travail » serait donc, purement et simplement, la fin de l’humanité en tant qu’« espèce créatrice de nouveaux objets et de nouveaux symboles ».
Une telle vision ramène à leurs justes mesures les vieilles prophéties mille fois ressassées sur la fin du travail, ou sur son extinction du fait de l’expansion sans limites, hier de la machine, aujourd’hui du tsunami numérique – cette dernière rupture technologique mondialisée portant en elle la fatalité d’une dissolution du travail dans ses formes juridiques anciennes, au profit de nouveaux modes d’exploitation populairement identifiées par le terme « ubérisation ».
L’économie de l’apesanteur est largement une illusion
L’ouvrage développe une tout autre hypothèse : loin de signifier une quelconque fin, « la révolution numérique annonce la fin des catégories de pensée que la révolution industrielle a projetées sur l’agir humain. » Cela exclut toute fatalité et tout déterminisme, au profit d’une analyse politique des processus qui caractérisent l’organisation du travail, et des problèmes majeurs qui en découlent. L’auteur identifie trois processus majeurs, transversaux à l’humanité tout entière, et indissociables : technologique, écologique et institutionnel.
La révolution numérique annonce la fin des catégories de pensée que la révolution industrielle a projetées sur l’agir humain. Cela exclut toute fatalité et tout déterminisme, au profit d’une analyse politique des processus qui caractérisent l’organisation du travail, et des problèmes majeurs qui en découlent.
C’est à cette « communauté des problèmes » que se consacre la première partie du livre, en ouvrant la réflexion, modernité oblige, par la révolution numérique. Stéphane Mallat y invite à prendre en considération la possibilité d’un remplacement progressif du travail tel qu’on le conçoit actuellement, et qui devra être pensé autrement, sachant qu’un tel remplacement aurait des conséquences multiples – dont certaines potentiellement porteuses de progrès – mais globalement bouleversantes pour la société.
D’où l’urgence à réguler et à repenser le droit du travail, à refonder également les termes de la concentration des richesses et de la cristallisation des pouvoirs d’influence, tels que les incarnent aujourd’hui des sociétés privées, notamment les Gafam. Bernard Stiegler fait écho à cette vision en plaidant pour une nouvelle libération du travail, grâce à une économie de la contribution basée sur la revalorisation des savoirs et sur la possibilité donnée à chacun de créer de la richesse au niveau de ses capacités.
Cette possibilité d’une économie de contribution surgit comme une opposition à la prolétarisation et aux comportements mimétiques nés de l’industrialisation. À cette fin, l’auteur plaide pour une cybernétique critique et une restructuration des architectures de données, en phase avec l’objectif d’accorder une liberté d’action individuelle et collective. Pour Nicolas Countouris, cette perspective est aux antipodes d’un discours alternatif au travail tel qu’incarné par la société Uber et sa gouvernance du travail par algorithmes, mais elle appelle une extension positive du champ d’application du droit du travail. Si le défi est d’ampleur, l’auteur rappelle qu’il n’est pas nouveau, en citant l’article 35 de la Constitution italienne de… 1948, qui prend soin de préciser : « La République protège le travail sous toutes ses formes et applications. »
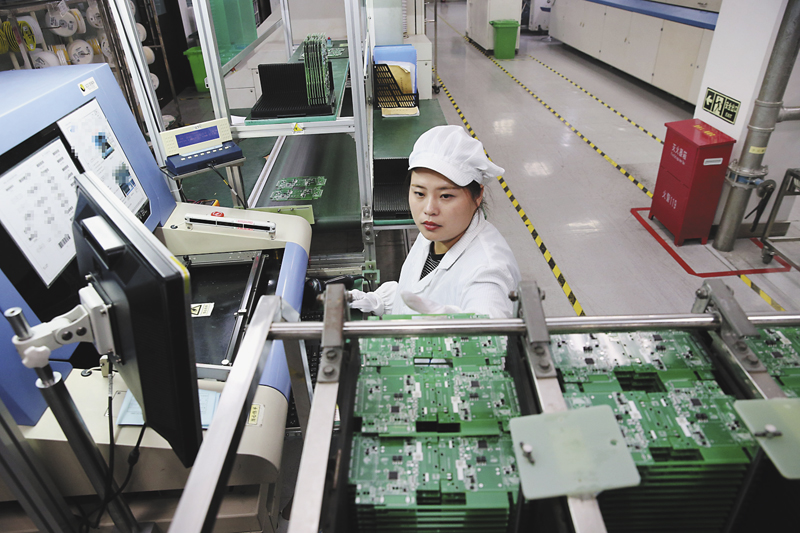
Délaisser la partie consacrée au défi écologique serait se priver d’un recul et d’un angle de vision précieux. Les contributions qui en traitent permettent en effet de raisonner sur la relation entre l’état des lieux et l’économie réelle, ses problèmes et les issues possibles, sans complaisance pour de quelconques illusions scientistes. À cet égard, Éloi Laurent rappelle que « l’“économie de l’apesanteur” est largement une illusion : le commerce de la terre et la transition numérique masquent un travail de la terre qui n’a jamais été aussi intensif. Nous sommes plus que jamais dans une économie de la pesanteur qui menace le bien-être en détruisant son habitat : la bio-sphère ».
Cette mise en garde est largement documentée par plusieurs approches des conditions du travail agricole ainsi que des enjeux alimentaires suspendus à son organisation, présente et future. On touche là au troisième défi, celui des institutions, singulièrement de celles qui organisent les conditions de la production et de l’échange au plan mondial. Y a-t-il un ordre international, y en a-t-il plusieurs ? Quelle place la jungle du droit international fait-elle et pourrait-elle faire aux outils existants qui permettent de protéger le travail, les travailleurs ? Dans cette complexité croissante, note Jean-Marc Sorel, « le problème est que ce glissement de l’utilisation du droit subit les interférences intermédiaires d’un“ordre transnational” qui, à vocation professionnelle dans le domaine économique, ne définit que des valeurs qui lui sont propres en termes d’efficacité économique et, dans ce cadre, les normes sociales sont envisagées a minima ».
Autant dire que, s’agissant des conditions de la production, de son rapport aux individus, à la biosphère ou à un ordre international, on reste loin de la déclaration de Philadelphie adoptée le 10 mai 1944 lors de la conférence générale chargée de définir l’ambition de l’Oit, déclaration qui donne pour objectif aux « différentes nations du monde » que les travailleurs soient employés « à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ». Cette formule, qui conjugue la question du sens du travail, du « pourquoi travailler ? » (pour contribuer le mieux au bien-être commun) et du « comment travailler ? » (en ayant la satisfaction de donner la mesure de son habileté et de ses connaissances).
C’est cette distance qu’explore la dernière partie de l’ouvrage, à travers un croisement de regards sur les expériences vécues en Inde, en Russie, aux États-Unis et en Chine, ainsi que dans les « vieux » pays industriels d’Europe. Loin de servir de simple illustration, ce voyage en diversité s’impose comme le passeport même d’une perspective de mondialisation. Il permet de prendre la mesure de l’interdépendance objective qui relève de la communauté des défis écologiques, techniques et institutionnels avec la diversité des milieux et des cultures nationales et régionales.
Pas de paix durable sans justice sociale
Dans ce foisonnement passionnant, dont la richesse même exclut toute synthèse, on retiendra pourtant la contribution d’Emmanuel Dockès sur la nécessaire adaptation du droit du travail et de ces deux notions clé que sont le « travail » et la « subordination », contribution assortie d’une mise en garde bienvenue sur l’effritement des idéaux démocratiques menacés par la brutalité d’un monde des affaires qui entend seul, penser et conduire le travail-monde. En quoi il rejoint la mise en garde souvent répétée d’Alain Supiot : « Trop d’injustices engendrent nécessairement, selon les termes de la Constitution de l’Oit adoptée il y a exactement un siècle, “un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger”. L’accroissement vertigineux des inégalités, l’abandon des classes populaires à la précarité et au déclassement, les migrations de masse de populations chassées par la misère ou la dévastation de la planète suscitent des colères et des violences protéiformes, qui nourrissent le retour de l’ethnonationalisme et de la xénophobie. Sévissant aujourd’hui dans la plupart des pays, à commencer par ceux qui furent les champions du néolibéralisme, la rage sourde engendrée par l’injustice sociale fait ressurgir partout le césarisme politique − fût-il de facture technocratique − et la dichotomie “ami-ennemi”. Se vérifie ainsi, à nouveau, le bien-fondé des dispositions du préambule de la Constitution de l’Oit et de la Déclaration de Philadelphie qui, tirant les leçons de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale, ont affirmé qu’“une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale”. » Un constat plus que jamais d’actualité.
Louis Sallay
- Alain Supiot (dir.), Le Travail au XXIe siècle, L’Atelier, 2019, 370 pages, 24,90 euros.
Du commun et des singuliers
Les 21 contributions de l’ouvrage s’organisent en deux grandes parties, la seconde venant éclairer la première à partir de situations locales.
« La communauté des problèmes » s’organise autour de trois grands défis posés à l’organisation du travail dans le monde : les défis technologiques, écologique et institutionnel. La révolution informatique ajoute en effet au paradigme de la subordination des travailleurs celui de leur programmation. Or, ce nouveau paradigme ne tient compte ni de l’expérience singulière et subjective du travail, ni des progrès techniques liés à l’intelligence artificielle. D’où de nouveaux risques et de nouvelles aspirations.
Le défi écologique, lui, est de nature anthropologique : c’est par son travail que l’espèce humaine s’inscrit dans son environnement et le transforme. Impossible, donc, de penser l’organisation du travail sans son empreinte écologique. Le défi institutionnel, enfin, touche au droit et à ses contradictions, alors que le commerce et la finance internationale traitent le travail, les médicaments, les cultures ou les ressources naturelles comme de purs biens économiques en compétition sur un marché sans frontières, sans tenir compte des normes que la sphère sociale et environnementale proclame nécessaire et universelle.
La seconde partie de l’ouvrage, à partir d’une série de coups de projecteurs sur de vieux pays industriels et des pays émergents, remet en cause l’idée d’une philosophie de l’histoire et, singulièrement, de l’histoire industrielle, qui est celle de la globalisation, conçue comme un processus d’uniformisation attisé par la mise en concurrence des systèmes sociaux. D’où un gigantesque refoulement de la diversité des cultures du travail, qui réapparaît sous des formes pathologiques. Une perspective authentique de mondialisation supposerait au contraire de tenir compte à la fois de l’interdépendance objective créée par la communauté des défis écologiques, techniques et institutionnels, et de la diversité des cultures nationales et régionales. Cette diversité est indispensable pour parvenir à un « régime réellement humain du travail ». L. S.