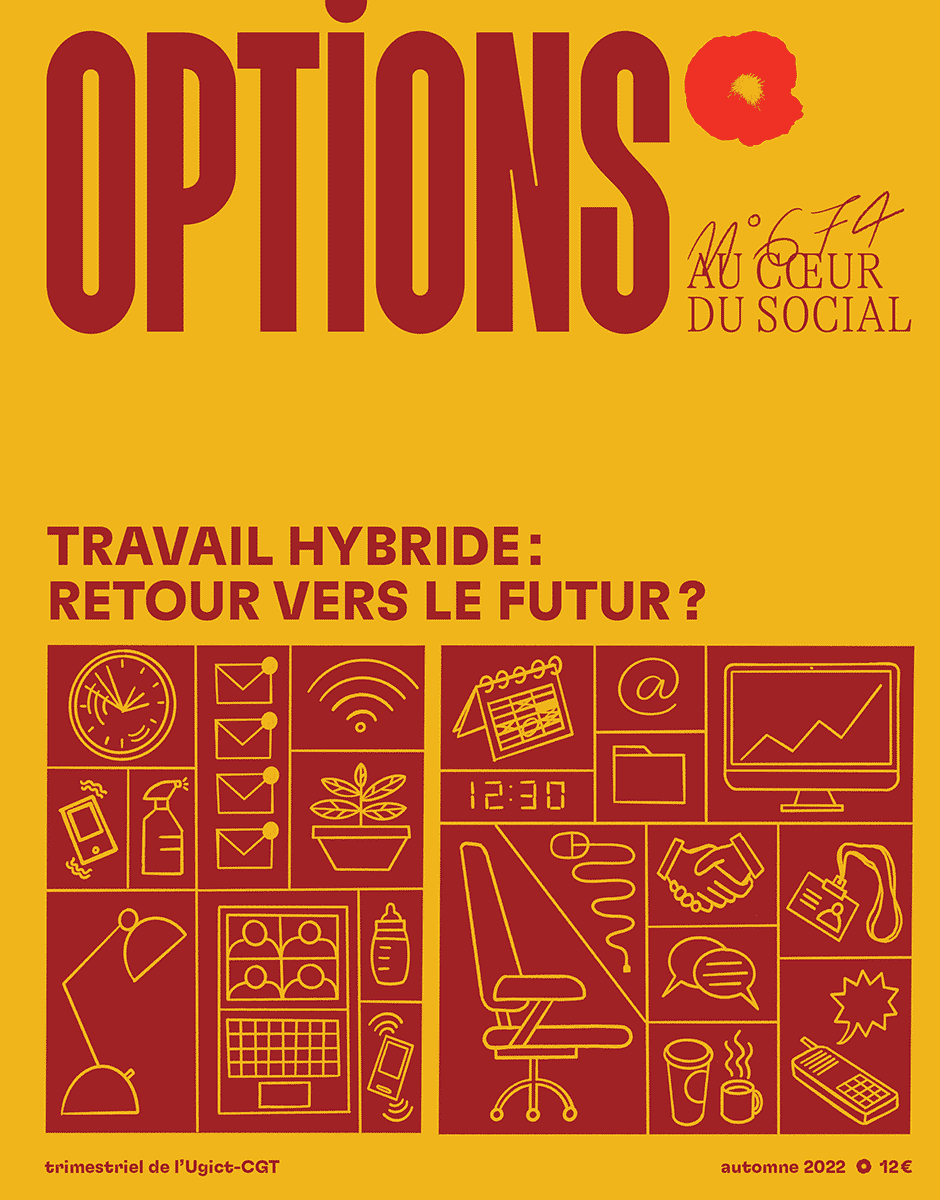Christian Salmon (écrivain) : « Clash et guerre des récits s’emballent dans une spirale, la spirale du discrédit »
22 mars 2019– Options : À quel « clash » le titre de votre livre fait-il référence ? – Christian Salmon : Ce que j’appelle le « clash » […]

– Options : À quel « clash » le titre de votre livre fait-il référence ?
– Christian Salmon : Ce que j’appelle le « clash » dans mon livre est un prisme au travers duquel on peut lire la vérité de nos sociétés. Et cette vérité, c’est le discrédit général qui frappe tous les discours. Lorsque les mots ne signifient plus rien, lorsque la parole publique est frappée de soupçon et que tous les narrateurs « autorisés » – hommes politiques, médias, éditorialistes, intellectuels – sont discrédités, il n’y a plus que la violence verbale pour se faire entendre dans le monde hyperconnecté qu’est devenu le nôtre. La logique du clash s’empare alors des échanges entre les hommes. Elle devient le nouveau paradigme de la communication. Désormais, viralité et rivalité vont de pair, virulence et violence, clash et guerre des récits s’emballent dans une spirale que j’appelle la spirale du discrédit.
– Comment en est-on arrivé là ? Comment ce discrédit est-il advenu et de quoi s’alimente-t-il ?
– Cette spirale du discrédit dessine trois cercles successifs qui rayonnent autour de trois dates : 2001, 2005 et 2008. Chacune de ces dates constitue l’épicentre d’un effondrement de la confiance dans le langage.
2001, c’est l’attentat contre le World Trade Center, qui va engendrer une explosion des théories complotistes tant l’événement apparaît comme un défi, non pas seulement à la raison, mais aussi au récit. Ce sont les questions restées sans réponse qui produisent le récit complotiste. Le « 9/11 » constitue un arrêt de récit, le ground zero du grand récit américain.
2005, c’est l’apparition et le développement des réseaux sociaux, une nouvelle agora publique qui va se transformer en un « ogre » dévorant les attentions. La transgression y est la règle : il faut cliver plutôt que s’assembler. On y obtient une notoriété en ruinant celle des autres… Une société du tacle plutôt que du spectacle. On y devient fameux par l’infamie qu’on y répand. Les haters sont populaires. Ils cherchent à provoquer non pas l’empathie mais l’antipathie, non pas la continuité mais la rupture : insultes, tacles, fake, hoax… Le « clash » devient l’aiguillon de la conversation nationale et les « j’aime » (like) signifient le plus souvent « je hais » (hate). Racisme, antisémitisme, sexisme, machisme, homophobie y trouvent un espace de contagion à l’abri de l’anonymat.
« Il n’y a plus que la violence verbale pour se faire entendre dans le monde hyperconnecté qu’est devenu le nôtre. La logique du clash s’empare alors des échanges entre les hommes. Elle devient le nouveau paradigme de la communication. »
Christian Salmon
– Et 2008 ?
– 2008, c’est une crise financière mais aussi une crise de la narration. La crise de 2008 a révélé le décrochage de la parole publique par rapport à l’expérience concrète des hommes. L’effondrement du storytelling néolibéral va ouvrir la voie au Brexit, à l’élection de Donald Trump, à la poussée électorale de l’extrême droite en Europe. Tout ce qui a été refoulé depuis trente ans par ce récit néolibéral tenu aussi bien par la droite reaganienne que par la gauche blairiste resurgit sous une forme chaotique, sauvage mais résolue.
Ainsi s’esquisse une double tendance : d’un côté, la tentative d’instaurer, voire d’imposer un certain ordre narratif – celui des « gouvernants » – et de l’autre, la dé-ferlante des évènements qui bousculent cet ordre narratif. D’un côté, une logique narrative qui jette son filet de récits sur l’atomisation des expériences de l’autre, une logique de rupture, aveugle à elle-même, une contre-puissance obscure, celle du monde qui résiste aveuglément à sa mise en récit. Les gilets jaunes en sont le produit.
– Vous critiquez beaucoup les réseaux sociaux. Pourtant, ceux-ci ne sont-ils pas, depuis 2011 et les révolutions arabes, ceux qui ont permis des mouvements que personne n’attendait ?
– Au moment des révolutions arabes, Alec Ross, le brillant conseiller pour l’innovation d’Hillary Clinton, a déclaré : « Le Che Guevara du XXIe siècle, c’est le net. » Il y a là une forme de croyance magique dans le pouvoir des réseaux sociaux qui seraient capables de provoquer un changement démocratique en favorisant l’alliance entre la mobilisation populaire et les applications comme Twitter, Facebook et YouTube. Or, c’est la pensée critique qui est dangereuse pour un régime, pas la technologie. Quand les gens descendent dans les rues, c’est toujours pour les mêmes raisons : la misère, la corruption, le chômage. On veut nous faire croire que les révolutions sont l’œuvre des réseaux sociaux dont les masses, par une bizarre inversion, seraient devenues les instruments : c’est une illusion.
– Pourriez-vous nous dire quelques mots de cette « prison du possible » dans laquelle, dites-vous, nous sommes désormais confinés ?
– Les maîtres du monde aujourd’hui, ce sont les Gafam qui organisent une forme de domination par les algorithmes ; un rapport social médiatisé par des algorithmes. Les Gafam considèrent que l’accumulation de quantités énormes de données brutes permet de bâtir des modèles de comportement. Ils prétendent pouvoir prévoir ainsi la plupart des phénomènes sociaux et des comportements humains. Eric Schmidt, le directeur général de Google, l’affirmait récemment : « Nous savons en gros qui vous êtes, en gros ce qui vous intéresse, en gros qui sont vos amis. La technologie va être tellement bonne qu’il sera très difficile pour les gens de voir ou de consommer quelque chose qui n’a pas été, quelque part, ajusté pour eux. » Les Gafam constituent un nouveau modèle d’enfermement symbolique, une prison d’un genre nouveau. La prison du possible. Mais il y a une limite à la numérisation de l’expérience, comme il y a un reste dans cette division, et ce reste est explosif. Tout ce qui a été pacifié par les algorithmes resurgit ailleurs, sous une forme chaotique, sauvage.
– Et c’est cette impossibilité de nous projeter dans un ailleurs qui explique ces « événements voyous » auxquels vous faites référence ? Que revêt d’ailleurs ce terme ?
– Lorsque vous ne pouvez pas élaborer, c’est la violence qui parle à votre place. Plus s’intensifie la violence intégriste du système, plus il y aura de singularités qui se dresseront contre elle. C’est le sens de ces événements « voyous » qui prolifèrent hors de toute rationalité sur le fond d’un système politique complètement discrédité.
« Quand les gens descendent dans les rues, c’est toujours pour les mêmes raisons : la misère, la corruption, le chômage. On veut nous faire croire que les révolutions sont l’œuvre des réseaux sociaux dont les masses, par une bizarre inversion, seraient devenues les instruments : c’est une illusion. »
Christian Salmon
– Depuis quelques années, la scène sociale est marquée par le refus caractérisé des États de passer des compromis sociaux : est-ce là une autre déclinaison de ce clash dont vous parlez ?
– C’est la logique profonde à l’œuvre dans le néolibéralisme autoritaire qui a déconstruit un à un tous les rouages de l’État-providence, jusqu’à faire de l’État une start-up parmi d’autres, soumise aux marchés financiers et aux agences de notation par le biais de son endettement, et aux multinationales sous la forme du chantage à l’emploi. Tous les lieux de la délibération démocratique et de la négociation collective sont démontés les uns après les autres comme un vieux cirque de la démocratie sociale. Cette désintermédiation laisse le champ libre à l’explosion des violences.
Hermann Broch, un romancier autrichien, le constatait en 1934 : « Entre l’homme et l’homme, écrivait-il, entre le groupe humain et le groupe humain, règne le mutisme, et c’est le mutisme du meurtre, c’est le bruit terrible du mutisme qui précède le meurtre et qui a encore le son du langage, mais qui n’est plus langage. Il est seulement une explosion : explosion d’angoisse, explosion de désespoir, explosion de courage. »
– Que dire de ce sondage Ipsos qui assure que « 64 % des Français pensent que nous pourrions prendre le chemin d’une société dominée par la haine » ?
– L’Amérique de Donald Trump nous en montre le chemin, l’Italie de Matteo Salvini aussi. Fini les histoires, place au clash communicationnel. Seuls comptent les chocs, les traumas qui attirent l’attention. Sur les réseaux sociaux comme sur les marchés financiers, c’est la volatilité créée par des avis imprévisibles. Le « clash/tweet » qui fait du buzz se substitue au récit qui exige une certaine continuité pour dérouler les tours et détours d’une intrigue. La vie politique et sociale s’est transformée en une suite intemporelle de chocs. Pas de place pour la raison, la délibération, la symbolisation. Les mots sont calcinés. L’inflation des énoncés a produit, comme l’inflation monétaire avec la monnaie, le discrédit de la parole.
– Après l’ère du clash, que peut-on craindre… ou espérer ?
– Nous allons vers le crash du système démocratique. Inutile de se mentir. On ne peut, comme le fait Donald Trump, spéculer à la baisse sur le discrédit du système sans en aggraver les effets. La spirale du discrédit nous entraîne dans le gouffre, comme la crise écologique. C’est d’ailleurs une crise écologique, car le langage est notre oxygène. Nous sommes en train d’épuiser les ressources du débat public, c’est-à-dire le langage, les récits, la possibilité pour les hommes d’échanger leurs expériences.
Propos recueillis par Martine Hassoun