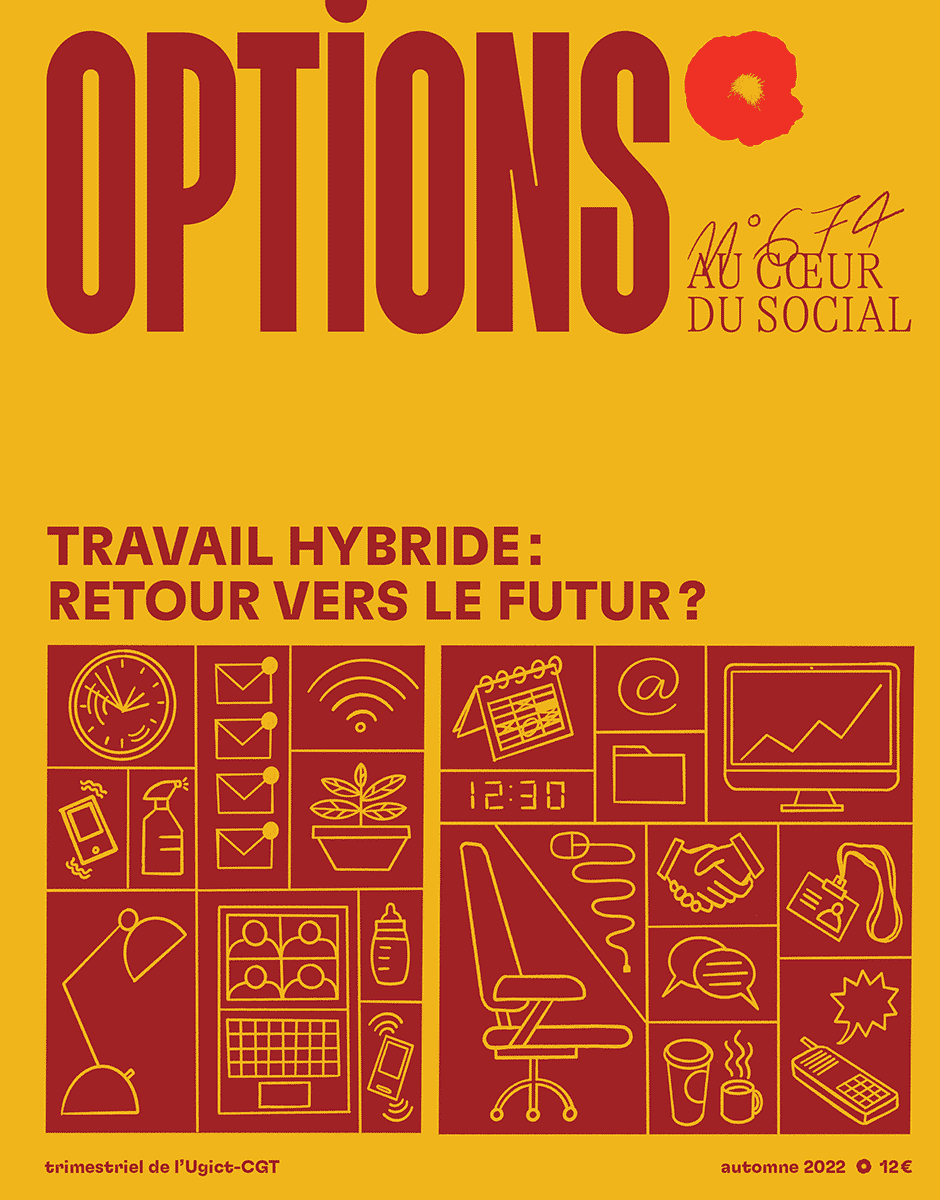Science et conscience à l’épreuve de la pandémie
5 septembre 2020– Options : D’un côté, la pandémie a réinstallé « la science » – sous-entendu : les sciences dures – en facteur de solution ultime à […]

– Options : D’un côté, la pandémie a réinstallé « la science » – sous-entendu : les sciences dures – en facteur de solution ultime à la pandémie, et facilité la promotion des chercheurs en experts politiques, voire en prescripteurs de politiques publiques. D’un autre côté, elle a favorisé une floraison de discours ascientifiques, allant de la négation pure et simple de l’épidémie à des prescriptions parfois surréalistes. Quels enseignements tirer de cette mise en visibilité paradoxale ?
– Philippe Dubois : Toutes les épidémies charrient leur lot d’angoisses, de rumeurs et bien sûr d’individus décidés à profiter de la crédulité d’autrui. Celle-ci ne fait pas exception, et un travail d’information critique est indispensable. Fort heureusement, la situation actuelle ne se réduit pas à ce problème de fake news et autres infox. Elle donne à voir des attentes collectives fortes et positives à l’égard des sciences.
La pression qui s’exerce sur la communauté scientifique et ses effets sont manifestes : production accélérée de publications et de prépublications, mutualisation des données brutes, réorientation massive des financements, etc. Mais cette pression est également parfois politique : à l’évidence, certains dirigeants font le pari que leur réélection se jouera en partie sur leur capacité à fournir au plus vite un vaccin.
Face à de telles dérives, il revient aux représentants des communautés scientifiques et médicales, aux responsables des sociétés savantes, de rappeler ce qui fait la spécificité du temps de la recherche, de se constituer comme des instances autonomes de régulation. Tout comme il revient aux scientifiques mandatés par les autorités publiques pour produire des recommandations d’anticiper sur toute forme de récupération ou d’instrumentalisation.
La situation en France n’est pas parfaite, mais les premiers retours que l’on a des membres des conseils scientifiques montrent une forme d’apprentissage, notamment par rapport aux crises sanitaires des années 1990. Il serait intéressant de comparer le fonctionnement du comité présidé par Jean-François Delfraissy avec celui qui a été présidé pendant par la crise dite de la « vache folle » par le Pr Dominique Dormont.
– Concernant le rapport confiance-défiance à l’égard des scientifiques, on a parlé, au plus fort de l’épidémie, d’une forme d’exception française, notre pays manifestant un niveau de confiance nettement plus fluctuant que celui des pays voisins. À quoi attribuer ce mouvement en forme de montagnes russes ?
– C’est encore un peu tôt pour réaliser une comparaison internationale solide, mais il est vrai que le résultat des enquêtes conduites avant l’été en Allemagne, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne suggère que la France connaît une évolution singulière, en particulier au plus fort de la crise, durant la période de confinement.
À l’étranger, la crise semble avoir eu un effet « booster » sur la confiance exprimée non seulement à l’égard de l’institution scientifique, mais également à l’égard des experts, qui sont traditionnellement des figures plus controversées dans l’opinion. L’enquête conduite, par exemple, par l’Open Knowledge Foundation en mai dernier montre qu’en Grande-Bretagne, plus de 60 % des personnes affirment que la crise les incite à accorder davantage d’attention aux recommandations formulées par les experts. Nous ne retrouvons pas ce type de dynamique en France.
L’enquête Cevipof conduite sur l’attitude des citoyens face au Covid-19 mettait en évidence, à partir d’un niveau initial de confiance à l’égard des scientifiques normalement élevé (autour de 85 %), une diminution de 10 points pendant le mois d’avril. Notre propre enquête, conduite dans le cadre du baromètre Covid 19 de l’Ipsos, montrait que 77 % des personnes interrogées considèrent que compte tenu de l’état de la science sur le coronavirus, elles n’ont ni plus ni moins confiance dans la science qu’auparavant. Les deux opinions opposées, plus confiance (10 %) et moins confiance (12 %) font presque jeu égal.
Pourquoi cette situation singulière de la France ? Sans doute faut-il mettre ces résultats en perspective avec ce que l’on sait des grandes tendances de la confiance. Les enquêtes valeurs menées régulièrement depuis les années 1980 montrent que la confiance spontanée à autrui est une dimension de valeurs très stable mais aussi traditionnellement plus faible en France que dans d’autres pays européens, en particulier dans le nord de l’Europe. Il faut garder à l’esprit cette tendance générale lorsqu’on interprète les résultats d’enquête.
Avec le coronavirus, d’autres facteurs plus conjoncturels ont pu contribuer à neutraliser l’effet « booster » observé dans d’autres pays, en particulier la relative confusion des experts autour des masques, la polarisation du débat scientifico-médical autour de l’hydroxy-choloroquine et ses alternatives, ou encore l’accumulation de tribunes mettant en cause personnellement les médecins chercheurs et leurs supposés conflits d’intérêts. Il y aura sans doute un bilan critique à faire de cette période.
La crise s’apparente par certains aspects à un « crash test » qui ne peut qu’inciter les chercheurs à débattre de leurs règles de conduite, de leurs façons de communiquer vers le grand public, ou encore de leur rapport à l’industrie ou aux autorités publiques. Là aussi il n’y a pas à faire l’hypothèse qu’il y aura un accord spontané sur l’ensemble de ces sujets.
– L’épidémie a-t-elle profondément modifié la perception qu’ont les Français de la science, de la recherche, de la culture scientifique en général ?
– La pandémie est une occasion exceptionnelle pour réfléchir à la diffusion de la culture scientifique. Beaucoup d’observateurs considèrent qu’elle donne la possibilité aux Français de voir la science « en train de se faire ». Ce n’est pas totalement faux. Il y a différentes façons d’exposer publiquement le travail scientifique. Et l’exposition dont bénéficie aujourd’hui la communauté scientifique rend visibles les forces mais aussi certaines des incertitudes ordinaires du travail scientifique. En particulier, la crise du coronavirus confronte brutalement le grand public à la difficulté des chercheurs et médecins à parler « naturellement » d’une même voix.
Ce point me semble très important. Il revient à tous ceux qui s’investissent quotidiennement dans la diffusion de la culture scientifique de faire comprendre en quoi ces désaccords, ces controverses, ces incertitudes s’inscrivent dans un temps plus long, celui de la découverte et de la formation progressive d’un consensus scientifique. Le consensus scientifique est très rarement donné, mais le plus souvent construit. C’est à vérifier à travers les enquêtes à venir mais, compte tenu du « bain de culture » scientifique auquel a été exposé le grand public dans les médias depuis le début de l’année, on peut faire l’hypothèse que certains mécanismes de la communauté scientifique sont aujourd’hui plus familiers.
Dans le prolongement de la controverse autour du Lancet, j’ai été par exemple frappé par le nombre d’articles de presse et de tribunes consacrés à la méthode scientifique, à l’éthique du soin ou encore aux évolutions récentes des publications scientifiques, comme du contrôle par les pairs. La controverse autour du Pr Raoult a été l’occasion de faire mieux connaître certaines des dérives du système Sigaps, qui module le financement des institutions scientifiques en fonction des publications des chercheurs.
Si le grand public accorde généralement un soutien sans faille à la démarche comme à l’institution scientifique, il est fréquemment plus partagé pour ce qui concerne les innovations qui sont associées au progrès scientifique et technologique.
– L’opinion semble distinguer la recherche proprement dite des usages qu’en font institutions et entreprises. D’où des résultats d’enquête qui manifestent une forme d’ambivalence. Les scientifiques sont-ils sensibles à cette ambivalence ?
– Effectivement, si le grand public accorde généralement un soutien sans faille à la démarche comme à l’institution scientifique, il est fréquemment plus partagé pour ce qui concerne les innovations qui sont associées au progrès scientifique et technologique. Certains débats publics ont marqué les esprits : les Ogm, les nanotechnologies, les antennes-relais, aujourd’hui le génie génétique ou l’intelligence artificielle. La France dispose, de ce point de vue, d’une série d’enquêtes créée suite à une demande de la Dgrst au début des années 1970, avec notamment un item que nous essayons de maintenir, d’une vague à une autre, afin de restituer l’impression générale de l’opinion publique concernant les effets de la science.
Si, au début de ces enquêtes, une grande majorité de l’opinion considérait que la science « apporte à l’homme plus de bien que de mal », depuis la fin des années 1980 nous observons qu’une majorité des personnes interrogées considèrent que la science apporte à l’homme « autant de bien que de mal ». C’est une évolution intéressante, d’autant plus d’ailleurs qu’une partie de la communauté scientifique n’est, elle-même, pas insensible à un discours critique sur les innovations techniques et plus largement aux différentes formes de mobilisations sociales et politiques.
Dans une enquête Ifop pour le Cnrs conduite en 2007 (1), et qui mériterait d’être réactualisée aujourd’hui, on se souvient que près de 80 % des scientifiques interrogés considéraient comme « acceptable » le boycott des produits alimentaires contenant des Ogm, près de 70 % la lutte contre l’implantation d’un centre de stockage des déchets nucléaires… Il est facile de comprendre pourquoi certains organismes de recherche communiquent peu sur ce type de résultats, mais ils montrent bien que la communauté scientifique n’est pas un espace clos, coupé des multiples débats et controverses qui traversent la société. On peut voir d’ailleurs depuis quelques années un effort collectif pour faire émerger une conception « responsable » de la recherche et de l’innovation, c’est-à-dire une approche de la recherche et du développement qui intègre dès le début une réflexion plus ou moins profonde sur les valeurs de la société.
– Quelles peuvent être les retombées de la crise sanitaire sur la façon dont la communauté scientifique envisage son rôle, ses responsabilités, son rapport à la chose publique ?
– Une fois sortie de l’urgence, la communauté scientifique sera sans doute conduite à dresser le bilan de cette période. La crise s’apparente par certains aspects à un « crash test » qui ne peut qu’inciter les chercheurs à débattre de leurs règles de conduite, de leurs façons de communiquer vers le grand public, ou encore de leur rapport à l’industrie ou aux autorités publiques. Là aussi il n’y a pas à faire l’hypothèse qu’il y aura un accord spontané sur l’ensemble de ces sujets. Il est fort probable que cette réflexion interne soit accélérée par le calendrier gouvernemental, puisque le débat sur la loi pluriannuelle de programmation de la recherche (Lppr) est désormais de nouveau à l’ordre du jour.
Propos recueillis par Louis Sallay
- Daniel Boy, « Enquête sur la responsabilité sociale du scientifique », Sciences et société en mutation, CNRS Éditions, 2007.