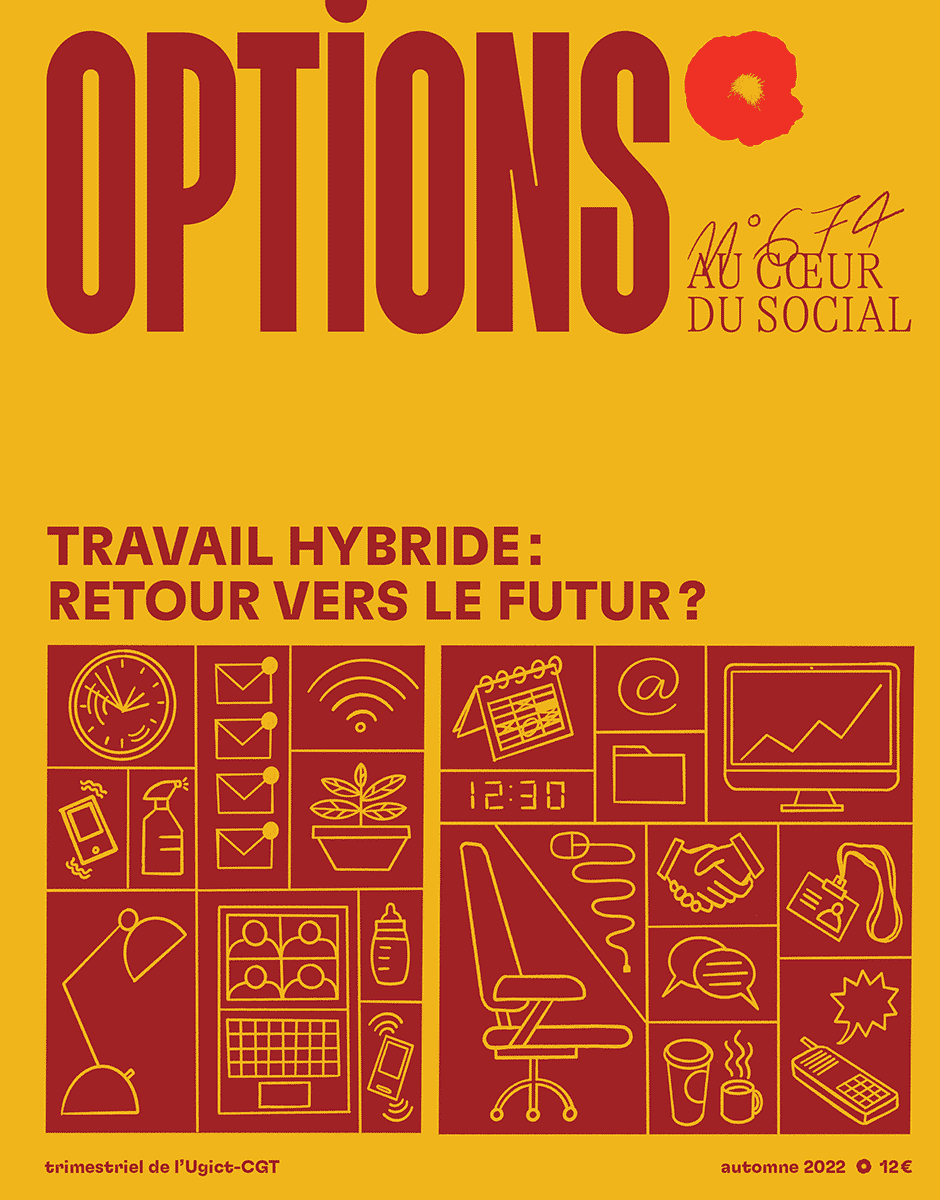Ségur de la santé : non, non, rien n’a changé
14 octobre 2021Clap de fin du Ségur, après le « clap clap » aux soignants ? Désormais, c’est un deuxième volet de mesures (dit Ségur II), […]

Clap de fin du Ségur, après le « clap clap » aux soignants ? Désormais, c’est un deuxième volet de mesures (dit Ségur II), consacré aux « transformations structurelles » du système de santé, qui est à l’ordre du jour. Mais les personnels hospitaliers et ceux des filières médico-sociales font toujours autant de bruit, partout, toutes professions confondues. Pour affirmer que le compte n’y est pas, qu’ils n’estiment toujours pas leurs qualifications et leur investissement professionnel reconnus à leur juste valeur par le volet « rémunérations et carrières » du Ségur, d’autant que leur quotidien reste insupportable.
Le ministre de la Santé avait pourtant assuré qu’un « choc d’attractivité » était indispensable pour répondre aux besoins du système, sans quoi la création de postes ne pourrait suffire. Pour preuve, en 2020, les établissements hospitaliers (public et privé confondus) ont encore fermé 5 700 lits d’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). C’est certes le signe d’une volonté de poursuivre les réductions de coûts en recourant toujours plus à l’ambulatoire. Mais c’est aussi la seule solution pour pallier le manque de candidats qualifiés acceptant de travailler aux salaires actuels. Les récentes suspensions de personnels non vaccinés (16 000 reconnus, auxquels il faut ajouter des centaines qui ont pris des congés, sont en arrêt maladie ou ont démissionné) viennent ajouter à la tension, d’autant que l’assurance maladie a donné des consignes pour repérer les arrêts maladie supposés injustifiés des professionnels soumis à l’obligation vaccinale. Pour rappel, ceux touchés par le Covid au début de la pandémie n’ont pas tous réussi à faire valoir leurs droits à la reconnaissance d’une « maladie professionnelle »…
Le « choc d’attractivité » n’aura pas eu lieu
La Cgt-Santé, premier syndicat du secteur, n’a pas souhaité s’associer au Ségur, déplorant qu’il ne s’agisse pas d’un réel espace de négociation, ce qui n’a d’ailleurs pas empêché que s’y décide – hors des instances officielles du dialogue social – une remodélisation des grilles salariales, avec quelques avancées en termes de revalorisations indiciaires. Au rang des « acquis », la prime de 183 euros de complément de traitement indiciaire (Cti), non négligeable pour certains bas salaires, n’a cependant pas été distribuée dans tous les secteurs et à toutes les professions, générant incompréhensions et frustrations. Le Cti se trouve, de plus, conditionné à l’exercice de certaines fonctions et ne peut donc être considéré comme définitivement acquis.
Dans le même esprit, le ministère ayant imposé une gestion des métiers et des postes au cas par cas pour limiter les concessions, chaque profession a été contrainte de se battre bec et ongles pour apporter la preuve de ses qualifications et savoir-faire. Dans cette période où ils sont sursollicités, tous engagés en première ligne, épuisés, les personnels ne pouvaient pas percevoir cela autrement que comme une insulte.
« Le gouvernement fait comme si la crise sanitaire n’avait pas légitimé nos revendications », souligne Jacques Duperret, animateur à l’Ufmict-Cgt du collectif techniciens hospitaliers, une des professions qui se sait indispensable mais a le lourd sentiment de travailler dans l’ombre sans la moindre valorisation, alors qu’elle revendique un niveau bac + 3 et le passage en catégorie A. Ils seront, pour la cinquième fois de l’année, en journée nationale d’action le 17 novembre, avant de nouvelles négociations en décembre : « Confrontés au quotidien à la souffrance des autres, les soignants ont parfois tendance à considérer qu’ils ne sont pas si mal lotis, et sous-estiment leur investissement, poursuit-il. Mais la crise sanitaire leur a aussi fait prendre conscience que le manque de reconnaissance et de moyens était orchestré. L’argent a coulé à flots pour les masques, les tests, les vaccins, malgré des prix scandaleux, alors qu’avant on pleurait pour un trombone. Le levier de la culpabilisation ne marche plus et, désormais, faute de reconnaissance, les démissions se multiplient. »
Particulièrement investis dans la crise sanitaire, les infirmiers anesthésistes diplômés d’État (Iade) restent également mobilisés après une journée de grève le 17 septembre, car malgré leur formation complémentaire et leur capacité à intervenir en autonomie dans des situations d’urgence – en réanimation et soins critiques notamment –, les grilles salariales ne suivent pas plus.
Derrière les masques, fatigue, frustrations, colère
Les sages-femmes ont, pour leur part, fait l’objet d’annonces satisfaites du ministère le 16 septembre : 100 euros de prime, plus un bonus indiciaire équivalent à 100 euros brut, soit guère plus que le Cti, et moins que les primes octroyées à leurs collègues des urgences avec qui elles travaillent souvent. Rien sur les effectifs, les conditions de travail, en particulier dans les nouveaux « centres périnataux de proximité » en projet. Et rien sur leur revendication d’obtenir le statut de « profession médicale et indépendante dans son domaine de compétence », s’appuyant sur une 6e année d’étude en internat, rémunérée et débouchant sur l’obtention d’une thèse d’exercice. Le 7 octobre encore, elles manifestaient.
« Les mobilisations se multiplient et se succèdent au fil des déceptions générées par le Ségur, constate le secrétaire général de l’Ufmict, Laurent Laporte. Les exigences sont fortes, car c’est la première occasion depuis vingt ans de réellement négocier dans une position où tout le monde mesure le peu de reconnaissance de notre engagement professionnel. » Même les médecins diplômés hors Union européenne, sans qui certains services hospitaliers ne pourraient pas fonctionner, restent sous-payés et même menacés de radiation (lire encadré). L’hôpital tient, mais les soignants n’en finissent pas de craquer.
Valérie Géraud
Praticiens à diplômes hors Ue : indispensables mais jetables ?
Pris entre le marteau d’un oukase législatif et l’enclume de la déloyauté administrative.

Ils sont quelques 5 000 « praticiens hospitaliers à diplôme hors Union européenne » (Padhue), exerçant comme médecins – y compris chirurgiens, dentistes, pharmaciens dans les établissements français. Souvent dans des déserts médicaux où les services ne sont pas fermés grâce à eux : ils ne rechignent jamais à prendre des gardes et à boucher les trous. Maltraités par les organisations et sous-payés : sous statut de « faisant fonction d’interne », de « stagiaire associé » ou de « praticien attaché ». Pas plus assurés de la pérennité de leur Cdd que d’un déroulement de carrière. Ils sont désormais dans une situation critique, à la suite d’un décret publié à l’été 2020, en application de la loi de juillet 2019 intitulée Ma santé 2022, qui les somme d’obtenir, avant fin 2021, leur agrément auprès des conseils de l’ordre de leur profession. Sauf que l’administration (commissions régionales et nationale d’admission) font preuve à leur égard d’un immobilisme déloyal du point de vue moral comme professionnel, et pour tout dire scandaleux.
Une des associations qui les représentent, récemment constituée en Syndicat national des Padhue (Supadhue), et qui s’est rapprochée de l’Ufmict-Cgt, a manifesté devant le ministère de la Santé le 27 septembre et y a été reçue : « Les Padhue sont soupçonnés de ne pas avoir les compétences cliniques et académiques équivalentes à celles exigées par les validations au sein de l’Union européenne. Pourtant, ils ont souvent une longue expérience dans leur pays et en France, exercent en responsabilité, aux mêmes postes que leurs collègues français ou européens. C’est bien qu’ils sont reconnus comme opérationnels, explique Brahim Zazgad, psychiatre dans un établissement de l’Aisne, président du Supadhue, qui a pour sa part réussi le parcours du combattant d’une « procédure d’autorisation d’exercice ».
Les exclus de l’intégration restent nombreux. Jusqu’à présent, il fallait passer des examens et un concours extrêmement sélectifs et n’offrant que peu de places chaque année – par exemple, cette année, en biologie médicale, 2 postes pour 50 Padhue en exercice. Il faut aussi déposer un dossier d’une centaine de pages à son agence régionale de santé, retraçant formation initiale et continue, carrière complète, spécialisations, recommandations de ses chefs de services et de pôle. Et attendre… Soit une autorisation, soit un rejet, soit la prescription d’un parcours de consolidation de compétences de plusieurs mois, souvent sur le terrain et sous statut de stagiaire…
Actuellement, malgré l’urgence, aucune commission ne semble accélérer la prise en charge des dossiers déposés. Les praticiens concernés, nombreux à avoir choisi la nationalité française et construit leur vie en France, restent donc dans l’incertitude quant à leur avenir. Par ailleurs, seuls ceux qui sont en poste depuis avant 2015 sont pris en compte dans le dispositif. Les derniers arrivés resteront donc peut-être en poste, mais risquent de rester des fantômes administratifs. Les Padhue entendent se battre avec les syndicats Cgt dans leurs établissements. Ils ont aussi pris contact avec des parlementaires et lancé une pétition. À suivre… V. G.