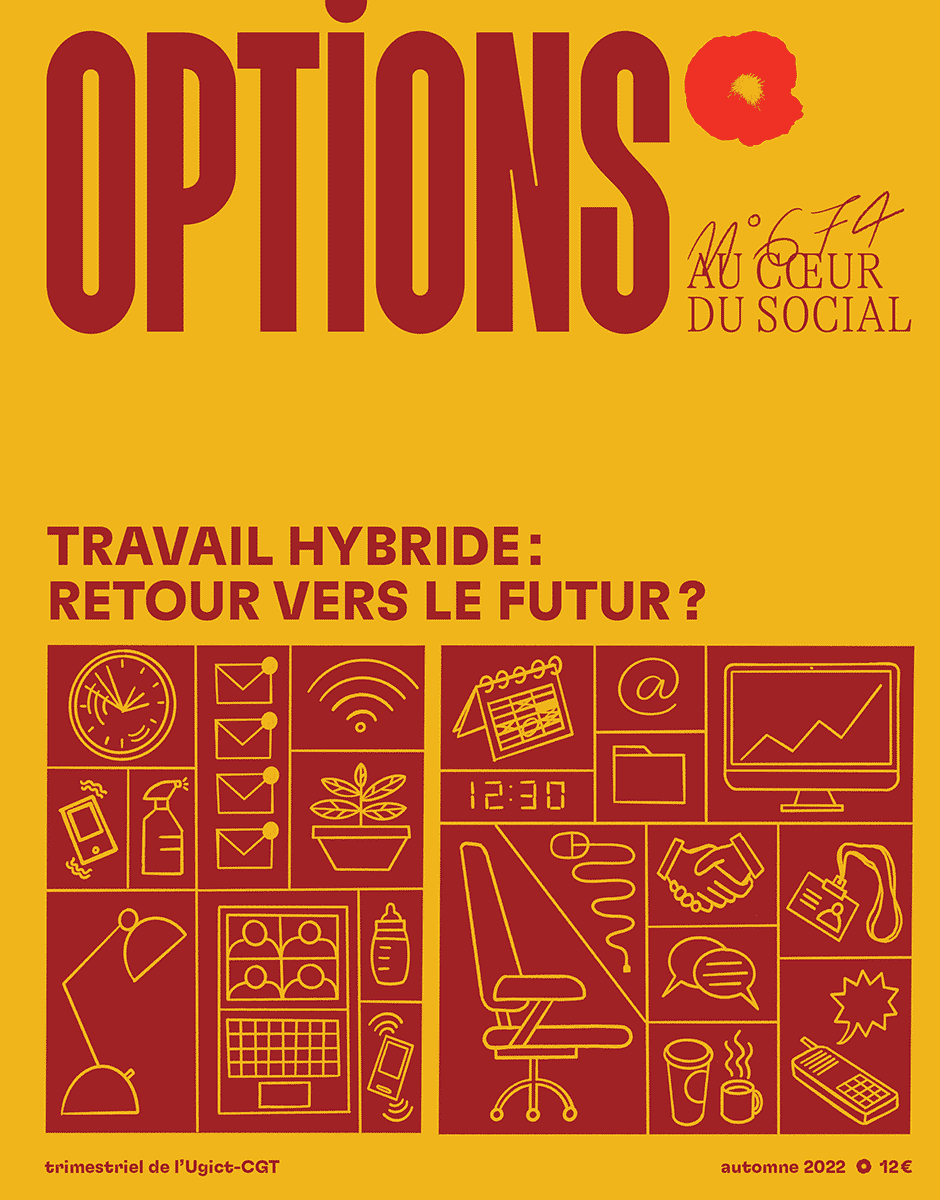Protection de l’enfance : notre affaire à tous
5 décembre 2020– Options : Les périodes de confinement ont exacerbé les violences intrafamiliales, y compris à l’égard des enfants. Quel bilan dresser […]

– Options : Les périodes de confinement ont exacerbé les violences intrafamiliales, y compris à l’égard des enfants. Quel bilan dresser en cette fin d’année ?
– Marie-Pierre Colombel : Lors du premier confinement, les associations et les services de protection de l’enfance ont été débordés. Nous nous sommes mobilisés ensemble autour de campagnes de sensibilisation, y compris sur les réseaux sociaux, pour faire connaître le 119, qui certains jours a reçu plus de 1 000 appels à l’aide et signalements. Les numéros verts d’associations comme Enfance et partage (0800-05-12-34) ont également été très sollicités. Même les enfants et les adolescents ont appelé, ce qui s’avère relativement rare en temps normal.
La crise sanitaire a créé un contexte explosif : fermeture des écoles ; promiscuité 24 heures sur 24 pour les familles vivant parfois dans des espaces trop petits, où adultes et enfants ont dû se partager l’espace et les outils informatiques ; précarisation de certaines familles où un parent a pu perdre son emploi ou une partie de ses revenus. Les tensions et les conflits se sont multipliés, et là où les équilibres sont fragiles, même certains parents qui n’étaient jamais passés à l’acte ont pu basculer.
La fermeture des écoles, la promiscuité dans des espaces parfois trop petits, où adultes et enfants ont dû se partager l’espace et les outils informatiques, la perte d’emploi d’un parent ont multiplié tensions et conflits. Certains parents qui n’étaient jamais passés à l’acte ont pu basculer.
Marie-Pierre Colombel
La situation a été moins grave lors du deuxième confinement, parce que les écoles sont restées ouvertes, que certaines activités extrascolaires ont été maintenues. Quant à caractériser ces violences, on estime notamment que les agressions sexuelles ont augmenté, sans plus de précision, mais on sait déjà que si l’an dernier, tous les cinq jours, un enfant mourait sous les coups de ses parents, le bilan s’aggrave désormais, à un tous les quatre jours…
– L’école est un refuge pour les enfants en souffrance. Est-ce aussi un endroit déterminant pour les actions de prévention, de repérage et de signalement des victimes ?
– L’école leur offre en effet un moment de répit, c’est souvent l’unique lieu où ils se sentent en sécurité et sont susceptibles de s’exprimer. L’Éducation nationale et les enseignants sont pour nous des partenaires essentiels, ce sont eux qui font le plus de signalements. Ils sont sensibilisés et ont appris à repérer un enfant qui s’isole, qui a des troubles du comportement, de la concentration. Nos bénévoles sont formés pour intervenir dans les établissements scolaires, y compris auprès des enfants. Nous organisons des ateliers ludiques permettant d’aborder les droits fondamentaux des enfants, le fait que leur corps leur appartient, qu’ils ont droit à un logement, à l’éducation, à la sécurité physique et affective.
Pour les classes de Cm1 et de Cm2, il s’agit d’un jeu de société ; pour les collégiens et lycéens, il peut s’agir de jeux de rôles ou de théâtre, de jeux vidéo ; pour les maternelles, de livres ou de marionnettes. Un enfant n’a pas les mots, ne comprend pas forcément, sur le moment, ce qui lui arrive, ou que ce n’est pas normal. Mais il arrive souvent que, lors de ces échanges, la parole des enfants maltraités se libère. Nous intervenons dans tous les milieux où il y a des enfants – crèches, cantines, centres de loisir, milieux sportifs – pour appeler tous les acteurs à la vigilance et les informer de ce qu’ils doivent faire s’ils repèrent un enfant en souffrance, ou sont témoins d’actes graves.
– Des enquêtes montrent que les témoins sont souvent réticents à dénoncer une situation de maltraitance envers un enfant. Comment l’expliquer ?
– L’institut Elabe vient d’enquêter pour nous sur la sensibilisation des Français à la violence envers les enfants. Ils en font leur première cause d’indignation, mais ignorent les outils à leur disposition pour l’empêcher ou la signaler. Par exemple, 62 % d’entre eux ne connaissent pas le numéro 119, et 81 % ne connaissent aucune association engagée pour leur protection. Même si 16 % des personnes interrogées déclarent avoir été elles-mêmes victimes de violences dans leur enfance, elles sont à peine plus nombreuses à penser avoir été, depuis, en contact avec un enfant victime. De plus, six personnes sur dix estiment qu’en cas de soupçons, elles attendraient d’être vraiment sûres d’elles avant de signaler une maltraitance ou une violence à l’égard d’un mineur.
Outre la difficulté à être perçu comme un délateur, il semble qu’au pays des droits de l’homme, il soit difficile de concevoir intellectuellement qu’on puisse piétiner ceux des enfants. Pourtant, la réalité, d’après les dernières statistiques du ministère de la Santé, c’est qu’en 2018, 52 000 enfants ont été victimes de violences, de mauvais traitements ou d’abandons, que 140 000 enfants ont été exposés à des violences conjugales, que 130 000 filles et 35 000 garçons ont été victimes de viols ou de tentatives de viols, en majorité incestueux. Rappelons aussi que le Code pénal condamne la non-assistance à personne en danger, et que la peine encourue est plus lourde quand il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans.
Il semble difficile de concevoir qu’on puisse piétiner les droits des enfants. Mais d’après les dernières statistiques du ministère de la Santé en date de 2018, 52 000 enfants ont été victimes de violences, de mauvais traitements ou d’abandons et 140 000 ont été exposés à des violences conjugales.
Marie-Pierre Colombel
– Votre association est reconnue d’utilité publique. Sur quelles autres actions concentrez-vous vos moyens ?
– Nous accompagnons des familles, des femmes seules, des grands-parents qui prennent en charge leurs petits-enfants, dans une démarche d’aide à la parentalité, y compris dès la grossesse (1). Nous travaillons en complémentarité avec les professionnels, qui sont parfois démunis, et avec les autres associations, notamment à des accompagnements psychologiques et juridiques. Nous œuvrons à faire mieux travailler tous les acteurs – institutionnels, juges des affaires familiales par exemple, travailleurs des Aides sociales à l’enfance gérées par les départements, associatifs – pour dénouer ces situations complexes et graves.
Je suis administratrice ad hoc, c’est-à-dire habilitée à représenter un mineur et à me porter partie civile en justice. Nous le faisons, en complément du ministère public, dans les cas où les enfants n’ont personne pour les représenter – quand il n’y a pas de parent pour le faire ou que les parents sont sur le banc des accusés. Nous tenons à apporter un soutien plus humain à la victime, à montrer que son sort compte aux yeux de la société. Symboliquement, nous représentons aussi les victimes prescrites, les morts, c’est important. Par exemple, dans un procès récent contre un homme qui détenait de nombreux fichiers pédo-pornographiques, où on n’a pas pu identifier les enfants, on donne du poids à leur existence et à leurs souffrances.
– L’action de l’État pour la protection de l’enfance vous semble-t-elle à la hauteur des besoins ?
– La cause des enfants a beaucoup progressé ces dernières années. Dans les nombreuses instances où nous siégeons, nous sommes écoutés. Les mesures du « Pacte pour l’enfance » lancé fin 2019 et celles annoncées fin novembre vont dans le bon sens. Notamment les moyens supplémentaires pour la prévention et l’écoute, le contrôle des adultes qui travaillent avec des enfants, le fichage national des personnes condamnées pour pédopornographie. Nous voudrions aller plus loin, par exemple, dans ce dernier cas, en instaurant des condamnations plus lourdes, y compris pour ceux qui consultent les images pédopornographiques.
Concernant les violences sexuelles, nous voudrions faire entendre raison au législateur sur la question de l’âge du consentement. La justice estime qu’un acte sexuel sur un mineur de plus de 15 ans est moins grave que sur un enfant plus jeune. Récemment, des relations sexuelles imposées à une pré-adolescente de 11 ans ont été requalifiées de « viol » à « agression sexuelle » ! Pour qu’il y ait viol il faut prouver la menace, la surprise, la contrainte et la violence. Mais comment un enfant peut-il les verbaliser et les prouver ? Qui peut prétendre que si l’enfant ne se sent pas contraint, c’est qu’il consent ?
Avec de nombreuses associations, nous défendons également l’idée qu’il y a des parents toxiques pour leurs enfants, et que le lien parent-enfant ne doit pas à tout prix être une priorité, d’autant que certains enfants signifient très clairement que rencontrer leurs parents biologiques ne les aide pas à grandir en toute sérénité. L’autorité parentale reste également parfois problématique, quand il faut demander à un père, emprisonné pour homicide sur la mère, son autorisation pour emmener un enfant chez le dentiste…
Il y a des avancées sur ces questions. Dans mon département, le Rhône, quand ils savent que les rencontres parent-enfant peuvent s’avérer destructrices pour l’enfant, les travailleurs sociaux essaient de les espacer. Quand c’est possible, ils demandent et obtiennent une délégation de l’autorité parentale. La parole des enfants est de mieux en mieux prise en compte, le droit des enfants progresse, mais c’est un combat quotidien.
Propos recueillis par Valérie Géraud