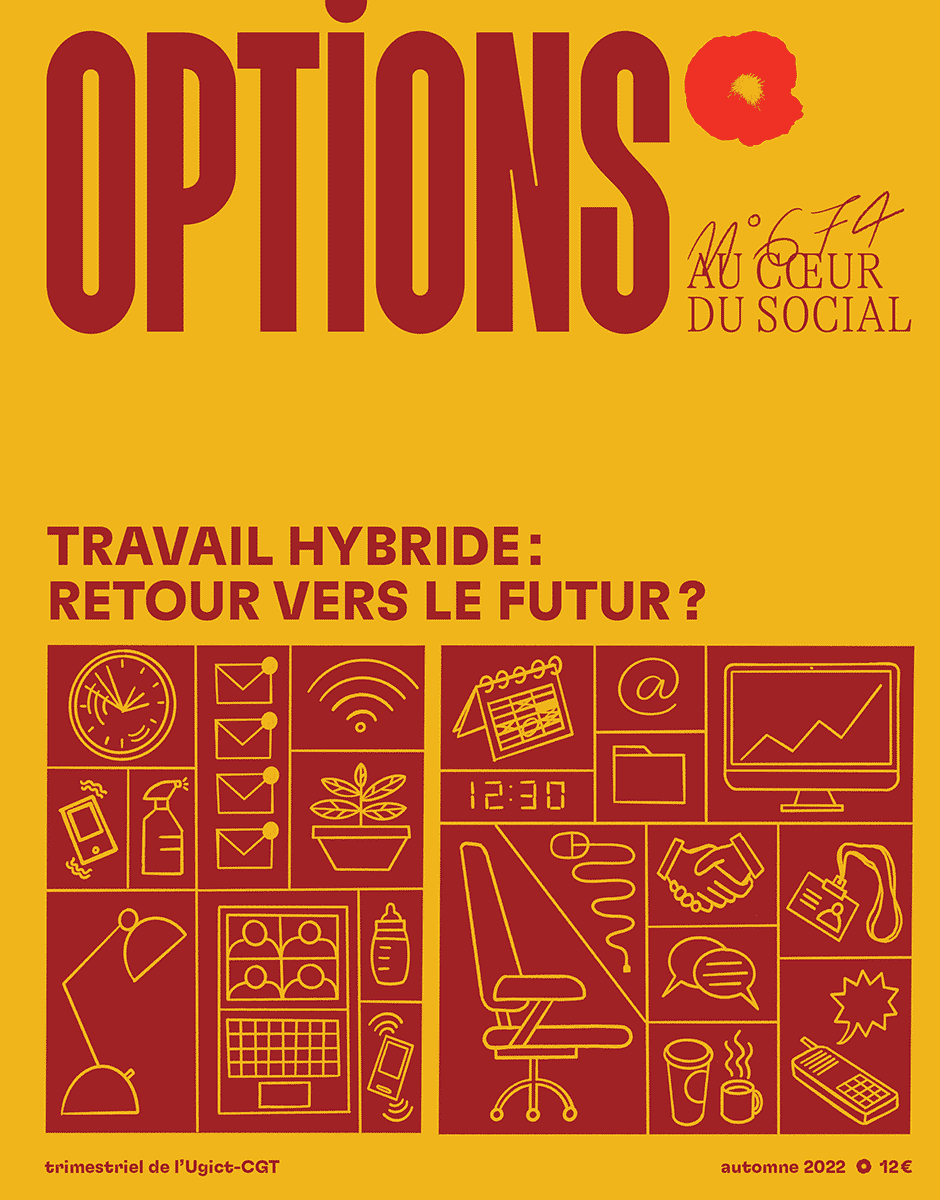Comment le Covid a bousculé les « communautés pertinentes d’action collective »
11 septembre 2021– Options : Le Covid a profondément impacté les sociabilités ordinaires, les organisations du travail, ses espaces et ses temps partout dans […]

– Options : Le Covid a profondément impacté les sociabilités ordinaires, les organisations du travail, ses espaces et ses temps partout dans le monde. Comment le syndicalisme risque-t-il d’en être affecté ?
– Jean-Marie Pernot : La crise sanitaire surgit, de fait, dans un moment de grande faiblesse pour le syndicalisme en France. Cet affaiblissement n’est pas propre à notre pays, mais s’inscrit dans un mouvement à l’échelle européenne, au moins (1). Elle a évidemment des impacts multiples sur le mouvement syndical. Je n’en retiendrai ici que deux, principaux à mes yeux. Le premier concerne la démocratie, les droits de manifester, de se réunir, de s’associer, tout simplement. Ces libertés, vitales pour une organisation, sont affaiblies par la distanciation sociale, par le port du masque et également par des politiques publiques. Lorsque les lois d’exception rentrent dans le droit commun, lorsque le contrôle social s’alourdit à travers le numérique, que le rôle des appareils répressifs grandit, cela crée un contexte difficile, qui met en jeu les libertés démocratiques.
Tous ces éléments sont antérieurs au Covid, mais la crise a permis de leur donner plus d’ampleur et plus de « légitimité » dans le débat public. Le second impact concerne le travail, tout ce qui le transforme et accélère des tendances, pour la plupart antérieures. Cette rencontre fortuite de technologies et de la pandémie est porteuse d’effets à court et moyen termes. Là encore, le Covid a permis une sorte de « généralisation vertueuse » des pratiques : nouveaux apprentissages autour du télétravail, du travail de plateforme et, plus généralement, à base d’algorithmes. La mise à distance d’individus traditionnellement réunis autour de tâches communes libère de la place pour des organisations informationnelles, contournant le contact direct. Elle modifie également les conditions de l’activité syndicale, ce que j’appellerai, après Denis Segrestin, les « communautés pertinentes d’action collective » (2).
– Les (ré)organisations informationnelles du travail ont replacé au cœur des débats l’enjeu du temps de travail et de sa réduction, sans que cela se traduise pour le moment par des mobilisations…
– Du temps de travail, oui ; de sa réduction… c’est une autre histoire. La dispute autour du temps a toujours été, et reste centrale. De fait, les processus d’automatisation permettent un gain de temps de travail, même s’ils se distribuent différemment selon les secteurs et… selon la façon de les calculer. Quoi qu’il en soit, l’appropriation de ce gain constitue un enjeu aussi vieux que la relation capital-travail : qui va se l’approprier et pour en faire quoi ? Le Medef réclame clairement qu’on rallonge le temps de travail, et le gouvernement inscrit cet allongement au cœur de ses projets de réforme des retraites. Face à quoi, le mouvement syndical oppose traditionnellement la revendication d’une réduction de ce temps pour, à la fois, combattre le chômage, soulager les travailleurs et reposer la question de la finalité sociale et humaine du travail.
L’objectif de réduction de la durée du travail pourrait faire l’objet d’un accord très large entre les organisations syndicales. Certes, chacune a une approche propre du sujet, mais toutes s’en soucient, et une convergence serait imaginable.
Pour le syndicalisme, c’est une question clé, au cœur de son « fonds de commerce » qu’est la défense du travail, et à l’origine de sa légitimité et de sa centralité. Pourtant, il faut bien le constater, cette question n’apparaît pas dans le mouvement social, et ses expressions revendicatives restent faibles – hormis pour les retraites. C’est d’autant plus regrettable que l’objectif de réduction de la durée du travail pourrait faire l’objet d’un accord très large entre les organisations syndicales.
Certes, chacune a une approche propre du sujet, mais toutes s’en soucient, et une convergence serait imaginable. Il y a d’ailleurs d’autres thèmes possibles de campagnes communes, pour la défense des services publics, la rénovation du système de santé, ou pour la reconquête d’une assurance chômage décente, tout ce qui constitue une sorte de « commun syndical ». Cela pourrait permettre de renouer avec une dynamique de conquête, d’espoir, qui fait cruellement défaut après tant de batailles perdues.
– Au sortir d’une phase longue de mobilisations fortes, très dynamiques, le mouvement syndical semble marquer le pas, comme essoufflé par un déficit d’organisation, de mobilisation voire de confiance, alors que d’autres formes de mobilisations revendicatives surgissent et s’enracinent…
– Le grand cycle conflictuel de 1995-2010 a plutôt abouti à des échecs revendicatifs. Il s’est accompagné d’un certain renouvellement du répertoire d’action collective, par exemple le déplacement de l’articulation grèves-manifestations. La manifestation s’inscrit dans une série et devient progressivement centrale, en lieu et place de la grève, moins présente en 2010 qu’en 1995, par exemple. Les pouvoirs publics, attentifs à la rue en 1995, en sont venus à une grande indifférence vis-à-vis de la protestation, qu’il s’agisse des retraites en 2010 (et en 2019), et à l’occasion des lois ou ordonnances sur le travail (2016-2017).
Avec 2012 et le grand éclatement syndical, qui parachève l’échec, s’ouvre un espace d’expression pour des mouvements qui portent des préoccupations sociales, qui empruntent aux modes et pratiques syndicales, mais qui témoignent surtout d’une dispersion des thématiques et des fronts de mobilisation. Cela se lit assez clairement dans le mouvement des gilets jaunes, auquel le syndicalisme en tant que tel n’a pris aucune part, du début à la fin, en se cantonnant à une sorte d’expectative – ce qui n’exclut pas la participation éclatée de militants ou ex-militants syndicalistes.
Il en est résulté, de fait, une sorte de mise en concurrence sur le terrain de la défense de l’intérêt général, ou de ce qui est perçu comme tel par nombre de travailleurs. Une telle situation est sans précédent, et c’est un signe parmi d’autres d’une perte d’emprise syndicale sur le social. Mais cet essoufflement vient de loin, il a lui-même ses causes, qui sont profondes et qui touchent à la représentation, à ce qu’est fondamentalement le syndicalisme.
Le rapport du travailleur au syndicalisme, c’est de se sentir représenté, autrement dit défendu, compris, et « dans le coup » à travers d’autres. Un moi dans un collectif.
Pour les travailleurs (et les travailleuses bien sûr), le rapport premier au syndicalisme, c’est de se sentir représenté, autrement dit, défendu, compris, et « dans le coup » à travers d’autres. Un moi dans un collectif. Ce ressort-là est brisé et à reconstruire. Cela suppose des pratiques syndicales élémentaires de représentation mais aussi, et plus profondément, une appréhension plus globale du tissu social sur lequel le syndicalisme doit travailler.
Ce qu’on appelle en économie le fordisme, de l’après-guerre jusqu’aux années 1970, a permis au syndicalisme de développer des dynamiques inclusives : schématiquement, ce qui profite à un secteur finit par profiter à tout le monde, même si c’est avec des inégalités entre branches, entreprises, territoires, etc. Développement et croissance incluent tous les salariés, qu’ils aient un rapport direct ou distancié au syndicalisme.
La pratique d’extension des conventions collective en est un exemple, elle permet d’inclure tout le monde dans un salariat à peu près stable ; cette dynamique inclusive se brise totalement dans les années 1980, sur fond d’internationalisation des grandes entreprises, avec un développement qui se fait à l’étranger. Dans ce cadre, les interactions économiques mutent. La négociation d’entreprise s’impose comme une sorte de « mieux que rien » au moment où, précisément, l’entreprise s’échappe, devient liquide, un « palais des courants d’air ».

Aujourd’hui, 80 à 90 % des entreprises sont prises dans un rapport de sous-traitance soit comme donneuses d’ordres, soit comme sous-traitantes et très souvent en cumulant les deux. Ce qui signifie que les interactions économiques et inter-entreprises se font par le marché, souvent sans aucune logique de profession. Les identités professionnelles dont les syndicats – surtout la Cgt – étaient des opérateurs ont été dépassées, sans qu’ils prennent la mesure des changements que cela appelait de leur part, notamment en termes de structures.
– La Cgt a pourtant mis en débat – et en pratique – de nombreux changements autour de ces mutations d’identités professionnelles ; des fédérations de services publics ont su s’ouvrir aux salariés du privé, des structures inter-professionnelles et territoriales ont été mises en place…
– C’est exact, et ça se poursuit. Mais peut-être sans que cela atteigne une dimension significative et, surtout, à un moment où le syndicalisme, fragilisé par des tas de facteurs, est soumis à la vieille tentation de « s’appuyer sur ce qui tient » ou qui semble tenir… Le syndicalisme français a su analyser, au début du XXe siècle, les conséquences du machinisme sur le travail, et passer du collectif défini par le métier à un collectif défini, lui, par ce qu’on contribue à produire. Cela a conduit, après bien des efforts (et quelques crises, il faut le reconnaître), à la généralisation des fédérations d’industrie, consolidées plus tard par les conventions collectives.
Aujourd’hui, c’est un changement du même ordre qu’il faudrait penser : mettre davantage d’interprofessionnel en haut comme en bas, dans la conception des syndicats. Mais l’exercice n’est pas simple : penser le changement est une chose, le mettre en œuvre, une autre, d’autant plus délicate que les employeurs ne restent pas inertes et que la sous-traitance systématisée précarise, affaiblit, isole et déclenche des dynamiques qu’il est difficile de combattre.
– Ce changement n’est-il pas annoncé par des mouvements comme celui des livreurs de Deliveroo, et mis en perspective par des alliances avec des partenaires associatifs, telles que les ont formalisées tant la Cfdt que la Cgt ?
– C’est une question qui renvoie à trois réalités bien distinctes, même si elles sont articulées entre elles. La première touche aux « nouveaux conflits », de type Deliveroo. Ils indiquent d’abord que la conflictualité et l’aspiration à l’action collective restent bien présentes. Ils confirment également que si l’on ne voit pas énormément de « jeunes » dans les syndicats, c’est bien parce qu’ils ne sont pas présents là où travaillent ces jeunes – autrement dit, les intérimaires, les sous-traitants, tous ceux qui sont, de fait, placés à la périphérie du lieu où on décide de leur sort à leur place.
Dans un tel cadre, le rapport à la représentation se dilue, le travailleur ne voit plus très bien quel est le lien entre lui et un collectif, ne distingue pas la parole dans laquelle il pourrait se projeter. À partir de quoi, tout appel à rejoindre un syndicat devient très largement incantatoire. Cela n’exclut ni luttes ni organisations mais ne suffit pas à les hisser à un niveau tel qu’elles puissent échapper à leur fragmentation.
Les alliances avec des partenaires extérieurs au champ syndical et porteurs d’expertises et d’approches légitimes sont incontournables. Le syndicalisme peut y apporter beaucoup. Mais elles n’excluent ni contradictions ni conflits et ne doivent pas conduire à faire l’économie de la question décisive des alliances entre organisations syndicales elles-mêmes.
La seconde question est celle des alliances avec des partenaires extérieurs au champ syndical et porteurs d’expertises et d’approches légitimes, qu’elles soient scientifiques ou militantes. Les enjeux climatiques, la crise sanitaire, les luttes féministes, imposent ces coopérations et il serait d’autant plus dommage de s’en passer que le syndicalisme peut y apporter beaucoup. Ces bougés sont donc bienvenus, à condition de bien les gérer. Ils n’excluent ni contradictions ni conflits, et personne n’est étranger à leurs enjeux.
Mais ils ne doivent pas conduire, troisième enjeu, à faire l’économie de la question des alliances entre organisations syndicales elles-mêmes. Il s’agit d’un prérequis : sans un changement visible dans les relations intersyndicales, le risque est grand d’aller vers une indifférence de masse de la part des travailleurs ; on y est déjà pour une part, comme en atteste participation aux élections sociales. J’aime rappeler cette formule de Tocqueville : « Les plus grandes menaces qui pèsent sur les religions sont le schisme et l’indifférence. » Le schisme est déjà là, l’indifférence n’est pas loin. Certes, le syndicalisme n’est pas une religion, mais il faut quand même que les travailleurs y croient pour que cela fonctionne, pour retrouver du bonheur à revendiquer ensemble.
Propos recueillis par Pierre Tartakowsky
- Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch, Thorsten Schulten, « Rough waters, European Trade Unions in a Time of Crises », Institut syndical européen, 2019.
- Denis Segrestin, « Les communautés pertinentes de l’action collective : canevas pour l’étude des fondements sociaux des conflits du travail en France », Revue française de sociologie¸ avril-juin 1980.