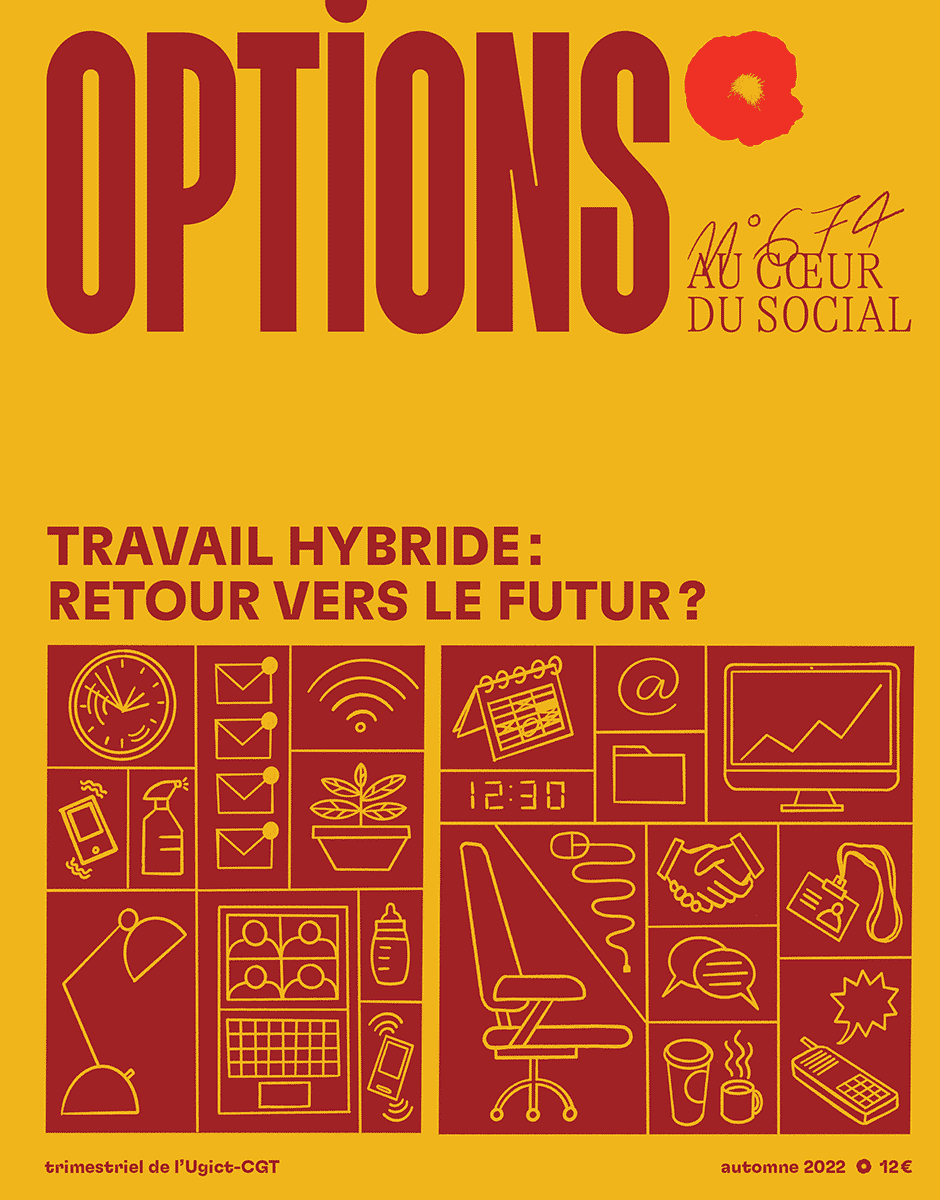Table ronde – Les techniciens au rendez-vous récurrent de la reconnaissance
22 avril 2019Participants : Hervé Chaillou, technicien aéronautique, Ufict Métallurgie ; Claire Delore, orthophoniste à l’hôpital public, Ufmict Santé ; Valérie Gonçalves, […]
Participants :
- Hervé Chaillou, technicien aéronautique, Ufict Métallurgie ;
- Claire Delore, orthophoniste à l’hôpital public, Ufmict Santé ;
- Valérie Gonçalves, animatrice du pôle Professions intermédiaires, techniciens et agents de maîtrise de l’Ugict ;
- Pierre Tartakowsky, Options.
– Options : Est-il possible, à partir de vos vécus professionnels et syndicaux, de tracer de grandes caractéristiques communes aux techniciennes et techniciens, au regard de leurs réalités de travail ?
– Valérie Gonçalves : On parle de quelque 5,5 millions de salariés, dont 1,5 million de fonctionnaires, avec une diversité qui englobe tous les aspects de la vie au travail. Diversité des profils, des niveaux de diplômes, des entreprises, des champs professionnels, des inégalités, à diplôme égal, entre secteurs, et particulièrement entre ceux qui sont massivement féminisés et les autres. Pour autant, le sondage Viavoice dégage des préoccupations communes, singulièrement l’équilibre entre travail et vie privée, l’aspiration à une juste reconnaissance des qualifications, à une revalorisation salariale.
On voit d’ailleurs émerger des «â€‰destins professionnels  » communs : la figure du manager, par exemple. Nous avons réalisé une enquête sur cette catégorie à Edf et dans sa filiale Enedis, d’o๠il ressort clairement une tension exacerbée entre les objectifs fixés et les besoins. Les besoins du travail à effectuer mais aussi ceux qui relèvent de ce travail particulier qu’est l’animation d’un collectif de collègues. à€ charge pour le manager de jouer de son professionnalisme pour élaborer des «â€‰arrangements  » permettant d’atteindre les objectifs fixés. Ce processus est souvent douloureux et exacerbe l’enjeu récurrent de la reconnaissance. De la reconnaissance de la qualification technique d’une part et, d’autre part, de la qualification managériale. Tout ceci renvoie évidemment au salaire, puisqu’une grande partie de ce travail, de cette mise en Å“uvre, n’est tout simplement ni reconnue ni payée.
– Hervé Chaillou : Comme technicien dans l’aéronautique, je dirais que ce qui domine, c’est le sentiment d’être entravé. àŠtre technicien, c’est avoir besoin d’une marge de manÅ“uvre vis-à -vis de son métier et de son objectif. Or, ce qui domine aujourd’hui, ce sont des organisations du travail extrêmement contraignantes. Concrètement, lorsqu’une étude est menée par une équipe ou qu’une tâche doit être finalisée, il est fréquent qu’on ne puisse pas aller au bout de l’étude, explorer toutes les pistes, les possibilités, les variations envisageables. Obtenir des résultats rapides exclut les échanges permanents, les temps de réflexion partagés avec les ouvriers, les ingénieurs, l’émergence d’une intelligence collective, au profit d’une simple exécution.
Ce système se retrouve aussi bien dans la production que, par exemple, chez les techniciens des bureaux d’études : il s’agit d’aller au plus court. C’est un facteur important de frustration, puisque cela empêche d’aller plus loin, de se dépasser, d’être créatifs. Tout cela revient à dévaloriser, voire à nier la dimension technique du métier, ce qui est justement ce par quoi on valide sa valeur propre. Le plus terrible, c’est que, dans la plupart des cas, le résultat n’est pas à la hauteur. Il est coà»teux en termes de retours, de temps, de coà»ts, de perte de compétitivité. D’o๠le sentiment des collègues d’avoir été placés en situation de mal faire leur travail et une déception massive par rapport à ce qu’ils sont en capacité d’apporter.
Ce qui domine, c’est le sentiment d’être entravé. àŠtre technicien, c’est avoir besoin d’une marge de manÅ“uvre vis-à -vis de son métier et de son objectif. Or, ce qui domine aujourd’hui, ce sont des organisations du travail extrêmement contraignantes.
– Claire Delore : je travaille à l’hôpital comme orthophoniste en Orl… le travail est pointu – bilans pré et postopératoires pour des patients sourds – et c’est une activité dont, malheureusement, on organise la disparition. En effet, la reconnaissance de la qualification, singulièrement salariale, est tellement faible qu’une fois formés, les orthophonistes quittent les hôpitaux et les postes salariés pour le privé, plus rémunérateur. Ce n’est pas une question de budget puisque nous représentons moins de 1 % des fonctionnaires publics hospitaliers. Cela relève plutôt d’une certaine conception de l’hôpital favorisant des soins très ciblés, avec 80 % d’ambulatoire, au profit d’un transfert des autres actes vers le privé.
Bref, on forme des gens «â€‰de passage  »â€‰: la durée moyenne de présence d’une orthophoniste dans un hôpital, c’est dix mois. Chiffres officiels. Cette situation porte en elle une sorte d’extinction. En effet, nous sommes largement formés par des professionnels, des cliniciens. C’est une formation par les pairs et, à plus de 50 %, par des hospitaliers. Si demain, il n’y a plus d’hospitaliers… Alors il serait exagéré de dire, comme Hervé, que l’on est «â€‰entravé  » même si on subit, au quotidien, une pression pour passer moins de temps auprès des patients, pour accélérer les procédures. Mais notre travail est tellement pointu que ces injonctions butent immédiatement sur la responsabilité et la technicité du métier. C’est une ligne de résistance. Encore faut-il avoir le mental et l’expérience. Avec quelques mois de présence comme perspective, cela n’a rien d’évident.

Virginie Gonçalves 
Hervé Chaillou 
Claire Delore
– On retrouve la reconnaissance de la qualification au cœur des enjeux de reconnaissance sociale. Quelles formes cela prend-il ?
– Hervé Chaillou : Lorsque je suis arrivé dans l’aéronautique, les techniciens étaient situés juste en dessous des cadres, et les relations entre les uns et les autres étaient clairement définies. L’arrivée massive d’ingénieurs a changé la donne : aujourd’hui un grand nombre d’entre eux occupent des postes qui, il y a dix ans, étaient dévolus à des techniciens. Un poste préparateur, en charge de préparer des gammes d’usinage qui permettront aux ouvriers de sortir une pièce, va être confié à un ingénieur, en lien avec des objectifs ou des promesses de carrière qui participent davantage de la gestion que de la production. De l’ingénieur aux techniciens, on subit ainsi un double processus de déqualification et de dualisation.
Aujourd’hui, très peu de cadres et d’ingénieurs techniques sont classés comme cadres supérieurs. Les techniciens, eux, subissent une véritable dépossession, surtout lorsqu’ils ont le sentiment que de jeunes cadres veulent leur «â€‰apprendre le boulot  ». Ce qui se joue, au-delà du seul salaire, c’est la fierté d’être ce que l’on est. Face à quoi beaucoup baissent les bras, se contentent d’obéir, ce qui, d’une certaine façon, revient à désobéir sans le dire… C’est assez dramatique parce que cela dégrade à la fois les personnes et le patrimoine des entreprises.
– Valérie Gonçalves : La déqualification est pointée par les salariés de tous les secteurs, elle arrive en troisième position dans le sondage Ugict-Viavoice. On retrouve ce phénomène de déqualification dans les fonctions publiques, puisque les concours mettent de fait en concurrence des diplômés de niveaux différents, au détriment de tout le monde, au final. Combiné à la perte de maîtrise, cela entraîne une incompréhension des organisations du travail et une perte de sens. Mais les pouvoirs publics suppriment les Chsct, qui avaient des pouvoirs effectifs dans ce domaine, et on s’accommode du fait qu’il n’existe pas, dans les entreprises, d’espaces de parole pour les salariés sur les organisations du travail.
– Claire Delore : De fait, on expérimente un peu les mêmes processus à l’hôpital. Tout le monde a pensé qu’en passant dans la catégorie A, la question de la reconnaissance salariale allait être réglée. Chacun s’est donc battu pour passer dans cette catégorie et a joué le jeu des diplômes universitaires en revendiquant un master. L’idée de l’université, de la transmission des savoirs, constituait un halo assez prestigieux.
Finalement, tout le monde s’est fait piéger. On est certes passés en catégorie A, mais un «â€‰petit a  », avec des tas de nouvelles grilles catégorielles, toutes différentes, ce qui fait que dans cette même catégorie A, on se retrouve avec une très grande inégalité de traitements. Avec un risque en prime puisque, dans la fonction publique hospitalière, les diplômes universitaires ne sont pas pris en compte ; ils ne sont pas corrélés à des grilles de salaire, alors que les diplômes d’État comme le nôtre, celui des paramédicaux, le sont encore. On est donc passés de 3 années d’études après le bac à 5 années, avec une revalorisation salariale infime. Cela a été imposé par le Processus de Bologne. Il fallait certainement augmenter le niveau de formation, tenir compte d’évolutions profondes. Mais cela a servi de prétexte pour diminuer le nombre de catégories dans le secteur public, réduire la masse salariale et faciliter de façon générale le passage au privé…
L’articulation entre grandes revendications unificatrices et luttes sectorielles a toujours été délicate et indispensable. D’o๠l’intérêt de disposer d’une organisation syndicale comme l’Ugict, qui Å“uvre à faire émerger du commun revendicatif et de la convergence entre catégories de salariés, en partant des situations et vécus propres à chacun.
– N’y a-t-il pas un décalage important entre la conscience des problèmes, telle qu’elle s’exprime dans le sondage, et ses expressions revendicatives ?
– Hervé Chaillou : le patronat de la métallurgie a toujours voulu dissocier salaire et qualification pour ne rémunérer que le poste. Avec la montée en technicité de tous les métiers, l’usine du futur et la digitalisation de l’économie, cela prend une tournure quasi obsessionnelle. Cela se nourrit aussi d’une diversité croissante des métiers, une diversité telle qu’il devient difficile, pour les salariés, de comprendre qu’ils affrontent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés dans leurs emplois respectifs. Dans mon entreprise, nos problèmes tiennent beaucoup au manque de personnel. C’est le même problème qu’à l’hôpital. Encore faut-il le savoir pour prendre la mesure des convergences possibles.
Le problème n’est pas nouveau, je le reconnais, mais ses termes ont changé et, surtout, les salariés ont changé. Les jeunes qui arrivent ont été formés de façon spécialisée au plan professionnel. Ils arrivent avec des aspirations, des modes de consommation très éloignés de ceux des générations précédentes. Disons qu’il y a un problème de culture politique, au sens le plus général : on peut être salarié, insatisfait de son salaire et penser que l’ubérisation de son métier permettrait de régler le problème… On peut dire qu’on a un problème de transmission, mais c’est sans doute plus profond que ça.
– Claire Delore : On a connu des périodes de grands mouvements revendicatifs et puis une période de reflux, avec des mobilisations catégorie par catégorie, service par service. à€ mon avis, cela tient au fait que les collègues veulent pouvoir maîtriser les revendications et qu’elles ne se retrouvent pas forcément dans des thèmes très généraux – l’emploi, le salaire – pas plus que dans des journées de grève qui sont vécues comme sans lendemain. Élaborer et maîtriser les revendications, c’est important. Avec des revendications précises, nous venons de faire, dans mon hôpital, une délégation à la direction générale avec des représentants de plusieurs services et aussi des orthophonistes.
Des mobilisations, il y en a, et beaucoup, que ce soit sur des problèmes particuliers, des demandes de prime, des soucis de service, souvent en rapport avec les effectifs. Et avec ces mouvements, la parole des collègues se fait plus libre, plus précise et plus exigeante sur les liens entre formation, situation de l’emploi, reconnaissance des qualifications. Personnellement, je ne serais jamais allée à une réunion d’orthophonistes si des collègues ne m’y avaient pas littéralement traînée. Pour moi, c’était du corporatisme, point final. Sur place, j’ai compris : loin de tout corporatisme, il s’agissait de formaliser nos revendications. à‡a, c’est notre responsabilité : faire le lien entre ce qui nous unit, sachant qu’on ne peut gagner en dehors des premiers concernés et que, bien sà»r, en même temps, on ne gagnera pas chacun dans son coin ! Les attaques sont diversifiées, les ripostes le sont fatalement.
Les collègues sur le terrain nous font confiance. Encore faut-il être présent sur le terrain. L’enjeu est bien celui-là . àŠtre avec et à l’image de toutes celles et ceux que nous invitons à se mobiliser, en l’occurrence les catégories techniciennes et intermédiaires. à€ mon sens, c’est exactement ce à quoi servent l’Ufmict et l’Ugict.
– Valérie Gonçalves : C’est justement pour contrer la mise en concurrence des salariés entre eux, entre professions et entre générations que s’est créé le syndicalisme confédéré. L’articulation entre grandes revendications unificatrices et luttes sectorielles a toujours été délicate et indispensable. Les entreprises sont traversées par les mêmes logiques de gestion, de management, de court-termisme et d’austérité salariale. De là à ce que se déclenche une riposte générale…
Les mobilisations catégorielles ou localisées constituent en fait un premier niveau de réponse, qui a nécessairement besoin de s’élargir, mais sans lequel cet élargissement serait chimérique. Or, organiser tout cela en convergence n’a rien de naturel. D’o๠l’intérêt de disposer d’une organisation syndicale comme l’Ugict, qui Å“uvre à faire émerger du commun revendicatif et de la convergence entre catégories de salariés, en partant des situations et vécus propres à chacun.
– Comment, alors qu’il existe une sorte de corpus revendicatif commun, expliquer que les salariés ne fassent pas spontanément confiance aux organisations syndicales pour défendre leurs droits et leurs emplois ?
– Hervé Chaillou : je crois que nous avons des difficultés, collectivement, à mettre en avant que le syndicat, c’est d’abord et avant tout la résultante de l’investissement des salariés eux-mêmes. Cela tient pour une part à l’identité forte du syndicat : la Cgt a une histoire, des valeurs, des engagements qui fonctionnent de fait comme autant d’exigences vis-à -vis du salarié lorsqu’il vient nous voir. L’accueil est d’autant plus compliqué lorsque les militants n’ont pas, eux-mêmes, une culture d’écoute et un souci pédagogique. Le risque est alors une attitude de repli vis-à -vis des innovations qui traversent la société et imprègnent les jeunes générations.
– Valérie Gonçalves : il faut nuancer ce constat. Il n’est pas satisfaisant mais renvoie davantage à un état des lieux qu’à une situation de divorce ou de défiance. Au vu de la crise qui frappe tout ce qui «â€‰représente  »â€‰â€“ partis, institutions, élus –, le syndicalisme ne s’en sort pas si mal. Mais, je le répète, c’est loin d’être satisfaisant : cela traduit un double éloignement préoccupant. Le premier se lit dans un chiffre : 8 % seulement des salariés sont syndiqués. Le second, qui découle du premier, c’est que, sur des territoires immenses, les salariés ne rencontrent jamais un syndicaliste. Cette situation est évidemment grave, surtout lorsque les structures syndicales elles-mêmes sont tendanciellement en décalage avec le vécu d’une masse de plus en plus importante de salariés et de travailleurs.
Enfin, cela fait maintenant plusieurs décennies que les gouvernements successifs ont littéralement organisé une marginalisation juridique et politique du syndicalisme, en réduisant le dialogue social à une caricature et en refusant toute négociation, quel qu’en soit le prix. Alors comment en sortir ? Avec les salariés eux-mêmes, en développant une activité revendicative qui colle à leur peau, épouse les contours de leurs problèmes – charges de travail, salaires, qualifications – et, surtout, de leurs aspirations.
– Claire Delore : Je vais être optimiste : les collègues sur le terrain nous font confiance. Le problème, effectivement, est qu’il faut être présent sur le terrain. Si on est hors sol, ou à côté de l’endroit o๠ça se passe, il y a de la distance qui s’installe. En juin 2016, en région Centre-Val de Loire, on a mené une bagarre exceptionnelle : grève des examens, assemblées générales… Tout le monde était uni : enseignants, professionnels et étudiants. Nous étions mobilisés, et nous nous sommes adressés au doyen, à la direction générale, à la ministre de la Santé. C’est le seul endroit o๠ça s’est passé comme ça. Nous étions plusieurs collègues organisées à la Cgt, cela a aidé, et nous étions vraiment en phase avec nos collègues. L’enjeu est bien celui-là . àŠtre avec et à l’image de toutes celles et ceux que nous invitons à se mobiliser, en l’occurrence les catégories techniciennes et intermédiaires. à€ mon sens, c’est exactement ce à quoi servent l’Ufmict et l’Ugict.