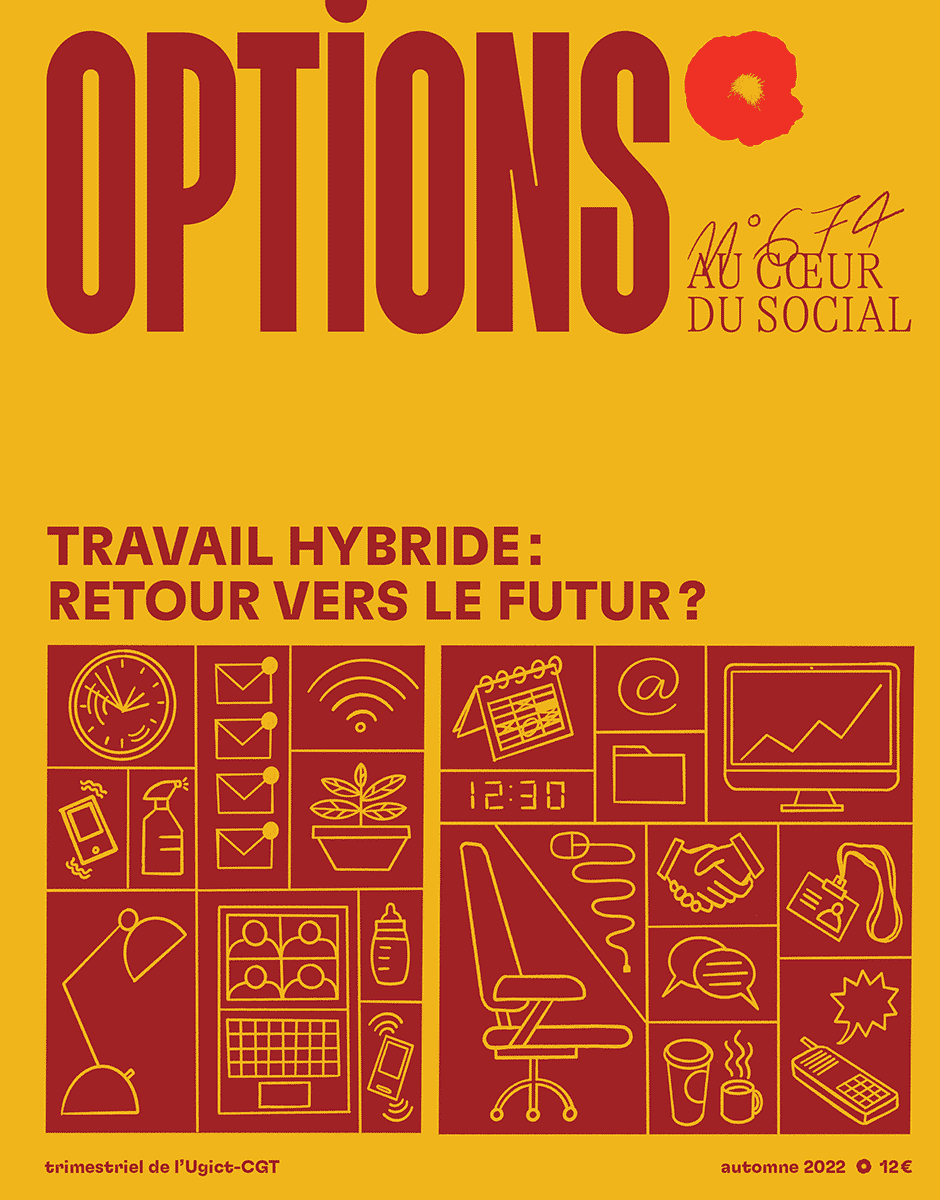Table ronde – Société : L’État peut en cacher un autre…
23 septembre 2019Participants : Thomas Deregnaucourt, membre de la Ce de l’Ugict-Cgt ; Karim Lakjaâ, président de la formation spécialisée n°3 du […]
Participants :
- Thomas Deregnaucourt, membre de la Ce de l’Ugict-Cgt ;
- Karim Lakjaâ, président de la formation spécialisée n°3 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- Estelle Piernas,membre du bureau de l’Union fédérale Cgt des syndicats de l’État ;
- Pierre Tartakowsky, Options.
– Options : La loi sur la fonction publique et les orientations du projet gouvernemental Cap 2022 dessinent une offensive d’ensemble contre les trois fonctions publiques. Comment la caractériser et comment se manifeste-t-elle ?
– Thomas Deregnaucourt : Les forces du néolibéralisme ont longuement présenté l’État comme le problème, comme l’ennemi, mais aujourd’hui, avec l’élection d’Emmanuel Macron, cet État est entre les mains de néolibéraux décomplexés qui estiment avoir le champ libre. Cela se traduit par exemple par la notion de « start-up nation », ou par l’assimilation des préfets à des entrepreneurs. Cela traduit le dogme libéral : on peut gérer l’État comme une entreprise. À cet égard, le rapport du Cap 2022 est sans mystère : on postule que les dépenses publiques ne sont plus soutenables au vu de l’environnement et de la compétition économique mondiale. L’objectif n’est donc plus de défendre un quelconque intérêt général mais d’assurer la compétitivité de « l’entreprise France ».
Il en découle que la fonction publique, ses statuts, les acquis démocratiques et sociaux sont autant d’obstacles à balayer grâce à la contractualisation, au new public management et à des outils adaptés au service des managers chargés de l’allocation de ressources matérielles et humaines : sanctions disciplinaires, variabilité des rémunérations avec une part de primes, mise en concurrence des statuts, précarisation des titulaires, mobilités forcées… Cela dessine véritablement un nouveau paradigme.
– Karim Lakjaâ : La loi dite de Transformation de la fonction publique aggrave, de façon brutale et autoritaire, les mécanismes de précarité déjà à l’œuvre. Dans la Fonction publique territoriale, elle annule tous les accords passés sur le temps de travail en rendant obligatoire leur renégociation avant le 1er janvier 2021. Les acquis sociaux sont non seulement visés, mais aussi leur vecteur : le syndicalisme de lutte.
Les auteurs de la loi n’en font d’ailleurs pas mystère : il s’agit, expliquent-ils, de percuter le fonctionnement même des organisations syndicales. Nous sommes donc confrontés à un projet agressif et à forte charge idéologique libérale. Le recours accru au contrat va conduire à une modification de la structure de l’emploi public et à une transformation globale du service public. Elle modifie sensiblement les organisations du travail et les relations entre agents en les mettant directement en concurrence. Ceci étant dit, il faut évaluer avec justesse le moment : la loi sur la fonction publique comprend 95 dispositions, dont 65 concernent directement la territoriale. Mais cet ensemble va s’appliquer, par tranches, de façon étalée, jusqu’en 2025. C’est dire que, pour la plupart de nos collègues, cela reste lointain. D’autant que beaucoup pensent que ces mesures ne concerneront que les futurs embauchés. C’est largement illusoire, mais cela contribue à retarder la prise de conscience.
D’où l’importance d’expliquer que ces mesures vont avoir un impact immédiat sur tout le monde, avec par exemple la rupture conventionnelle ou le gel des promotions, inéluctable puisqu’elles seront calculées sur la masse des seuls agents titulaires. Il est donc impératif de faire connaître à nos collègues le contenu de la loi. Contenu qui ne manque pas de les faire réagir. C’est un travail de longue haleine, qui suppose au préalable une information aux syndiqués – voire leur formation – et aux syndicats.
On voit se déployer un métalangage sur l’autonomie des acteurs, la territorialisation des besoins de santé, pour imposer à tous les échelons une gestion budgétaire stricte et autoritaire qui aboutit à supprimer des missions, des services, des réponses à des besoins particuliers. Ce primat du budgétaire s’accompagne d’un renforcement des moyens de coercition.
– Estelle Piernas : De ce point de vue, on n’en est encore qu’au début : les agents commencent à découvrir le contenu de la loi. Il y avait eu des prémices, notamment dans le secteur de la défense nationale, avec l’introduction de contrats sur des secteurs sensibles, liés à des tâches d’entretien des armements. Nous avions dénoncé la chose en soulignant le caractère insensé et risqué d’une décision remettant la sécurité d’opérations de terrain à des entreprises privées. Aujourd’hui, cette question reste sensible, et on voit, à l’Atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux, une forte réaction des personnels contre une tentative d’externalisation vers le privé, avec à la clé une série de problèmes.
De façon générale, on enregistre des mouvements, une turbulence, notoirement alimentée par des problèmes d’organisation du travail. On assiste à des assemblées générales, des rencontres entre collègues, à la volonté des salariés d’observer strictement les horaires, et on voit se multiplier les interpellations en direction des parlementaires et du ministère de tutelle. On retrouve, à la base de ces turbulences, à la fois la volonté de défendre le métier et une aspiration à la réaction collective. Ça peut sembler anecdotique, mais il y a fort longtemps qu’on n’avait pas assisté à ce type de manifestations.
– On assiste à une série de mouvements de résistance sociale dans les entreprises mais qui, pour la plupart, épousent une dimension corporative. Comment expliquer cette caractéristique et comment la dépasser ?
– Karim Lakjaâ : Nous avons observé des mouvements parfois spectaculaires comme celui des gilets jaunes ou encore celui des services d’urgence. Il y en a d’autres, comme par exemple, celui des pompiers des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), pratiquement tous en grève depuis le mois de mai. Le conflit porte précisément sur des questions de temps de travail et de mise en œuvre des missions. Mais, comme celui des urgentistes, il exprime une dégradation très forte et générale de l’exercice professionnel. Leur travail s’est en effet dégradé dans des proportions énormes, du fait d’une saturation qui tient de la crise sociale et du déficit d’effectifs. Et cette saturation s’est doublée d’une dégradation des rapports avec les populations.
Le passage à l’action collective doit beaucoup à ces caractéristiques propres, ainsi qu’à un très fort esprit de corps et à une intersyndicale très forte, très soudée. Mais il ne faut pas s’y tromper : s’il s’agit effectivement d’une mobilisation sectorielle, elle résonne avec les périls portés par la loi. Toute la difficulté, pour nous, réside dans notre capacité à articuler revendications proprement dites, concrètes, immédiates, avec une réflexion sur un en-cours plus global, qui cristallise la déstabilisation du travail, de son sens. Cette réflexion est d’autant plus difficile à mener que, je le répète, la loi n’est pas effective dans son entièreté.

Thomas Deregnaucourt 
Karim Lakjaâ 
Estelle Piernas
– Estelle Piernas : les mouvements revendicatifs dont nous avons parlé portent, de fait, une forte empreinte corporative ; c’est la marque du terrain professionnel sur lequel ils se développent et qui les nourrit. Tout le rôle du syndicalisme et notre responsabilité consistent à permettre que convergent les préoccupations et les demandes des salariés dans les administrations. Cela passe par une présence plus affirmée des organisations et des militants syndicaux sur le terrain, avec justement ce souci de ne pas se laisser enfermer dans les « silos » des administrations. Cela appelle également une mise en éclairage, de lucidité collective, sur les projets gouvernementaux.
C’est en articulant ce travail d’explication aux vécus professionnels, aux turbulences qui secouent les organisations du travail et, avec elles, l’éthique du travail, la conception des missions, que l’on peut peser sur les vécus et faire bouger les lignes. Il y a là un véritable enjeu, singulièrement autour des cadres, auxquels il nous faut donc accorder toute notre attention. Ils sont en effet au cœur des oukases néolibéraux, à la fois cibles et acteurs.
– Thomas Deregnaucourt : On peut toujours qualifier tel ou tel mouvement de « sectoriel ». Et après ? Il faut savoir ne pas s’en tenir aux apparences ou aux représentations médiatiques souvent superficielles, même lorsqu’elles sont bien intentionnées. Les services d’urgences voient passer un français sur six chaque année, ce qui implique une très forte visibilité et un impact important. Cela relativise, en soi, une quelconque « nature » corporatiste. Dans un secteur où le droit de grève a plus que du mal à vivre du fait des assignations, se retrouver avec plus de 200 services en mouvement, c’est inédit et indique une superficie conflictuelle plus vaste que le seul secteur en mouvement. Il opère en fait comme une caisse de résonance à une série de problèmes agrégés de longue date et qui tissent la trame d’une crise du système de soins.
Cette fonction de révélateur permet d’interroger toute la filière : le verrouillage du recrutement des médecins par le numerus clausus, la fermeture des hôpitaux de proximité, l’absence organisée de lits disponibles… Mis bout à bout, ces éléments resituent la crise des urgences dans un contexte hospitalier plus large. C’est d’ailleurs ce que le gouvernement a tenté de voiler en essayant d’acheter une sortie de grève avec une prime ici et une autre là. Cette grève sectorielle – et cela vaut également pour le mouvement qui a secoué les Ehpad – permet donc de penser la globalité de la politique dont procèdent les souffrances sociales et professionnelles qu’elle dénonce. Enfin, elle pose clairement la question du lien entre intérêt général et action syndicale. Lorsque la population comprend que la réduction de tels moyens, telles institutions, tels services, aboutit purement et simplement à réduire l’espérance de vie de certains patients, on crée les conditions d’une résistance sociale d’ampleur.
Nous avons 54 000 employeurs territoriaux, dont 230 concentrent 45 % de la dépense et 50 % des cadres. Ils sont soumis à la contrac-tualisation financière et contraints de baisser leurs dépenses, leur volume salarial. Cela représente 13 000 postes chaque année. Ce contexte explique que nos Drh multiplient des formations au management dispensées par des formateurs n’ayant aucune notion de ce qu’est le service public.
– Les réformes gouvernementales ne bénéficient pas d’un soutien large dans l’opinion publique, au contraire. Comment expliquer les difficultés du syndicalisme à y faire pièce ?
– Karim Lakjaâ : Pour la grande masse des agents, tout cela reste encore très théorique, et cela complique évidemment les mobilisations. De notre côté, nous élaborons des outils d’explication, qui sont très techniques et nécessitent d’être accompagnés de formations. Par ailleurs, nos organisations sont sollicitées sur d’autres sujets, les retraites, notamment. Pour autant, il y a une envie d’action, qui se mesure au nombre de préavis posés. Corrélativement, certains employeurs n’hésitent pas à appliquer, par anticipation, l’article 56 de la loi, qui vise uniquement la fonction publique territoriale. Il s’agit là d’une véritable machine à intimider tous azimuts et à sanctionner tout gréviste potentiel.
Cet article limitant le droit de grève dans certains secteurs doit théoriquement être mis en négociation pendant une année. Le fait que les employeurs se précipitent pour l’appliquer sans attendre risque de fonctionner comme un chiffon rouge et de beaucoup énerver… Est-ce que cela favorisera l’action ? C’est possible, à condition que nous fassions notre travail, singulièrement en direction des cadres.
– Thomas Deregnaucourt : Comment créer un rapport de force de masse, efficace, face à un gouvernement qui affiche en permanence sa volonté de ne rien céder aux demandes sociales ou populaires ? Les gens doivent avoir le sentiment qu’agir est utile. À cet égard, nous avons intérêt à valoriser les moments où il cède. Car il a dû céder et, aujourd’hui encore, il ne fait pas ce qu’il veut, comme il le veut. Syndicalement, nous avons donc tout intérêt à alimenter les démarches revendicatives spécifiques et les mobilisations qui, dans un premier temps peuvent apparaître comme sectorielles mais qui, de fait, recréent de l’espoir, attestent de victoires possibles et permettent à chacun de se projeter dans un intérêt collectif, un mouvement plus vaste, tissé de convergences.
Cela ne se décrète pas. Il faut y travailler, à partir de situations de travail concrètes, éclairées des conflits qui se mènent ailleurs. Mais ultimement, ce sont les salariés qui décident, ou non, de mettre à bas cette idée mortifère selon laquelle tout serait écrit d’avance. C’est ainsi qu’on peut remettre au cœur du débat public des alternatives, une dynamique positive, à condition de doubler ce travail de réflexions sur le fond.
On présente toujours l’intervention publique comme une entrave, une intrusion, un ensemble de contrôles tatillons. Il faut réhabiliter quelques idées simples et vraies : il y a des besoins de protection sanitaire, de garanties et de contrôles, d’éducation et de santé. Ils impliquent une gestion axée sur l’intérêt général. Cette notion permet aussi d’éclairer le rôle du statut contre toutes les formes de corruption qui écornent le contrat républicain et dégradent le débat démocratique.
– Dans ce contexte tout en tensions, comment concevoir le débat avec les agents des catégories de l’encadrement ?
– Estelle Piernas : Il nous faut prendre en compte que la situation va se tendre pour les collègues cadres. Sur le terrain, ils vont avoir de plus en plus de difficultés à accompagner leurs équipes. La généralisation des contrats de projets va aboutir à une limitation sévère de leur autonomie. Je crois qu’il y a là un énorme travail de sensibilisation à mener en misant sur les réalités du travail à accomplir et sur les contradictions qui vont s’exacerber entre ce qui est exigé et les moyens accordés pour y parvenir. Cela appelle le développement de formes d’échanges entre cadres, entre pairs, ce à quoi l’Ugict travaille. C’est l’un des moyens de battre en brèche le défaitisme ambiant.
Il nous revient d’organiser le débat en misant sur le travail et les rationalités qu’il porte. Un cadre, même s’il est un néolibéral convaincu, reste confronté au réel et est amené à constater que, à force de précarité des salariés, de mobilité forcée, de rémunérations bloquées, on l’empêche tout simplement de bien travailler et d’atteindre ses objectifs de façon satisfaisante.
– Karim Lakjaâ : Jusqu’à présent, les cadres devaient faire évoluer le volume d’emploi à la baisse. Désormais on leur demande de faire évoluer la structure d’emploi de leurs collaborateurs, de décider que tel poste sera un contrat de projet, autrement dit un contrat calé sur le calendrier électoral. Cela soulève des conflits éthiques, une préoccupation grandissante chez nos collègues. Sur tous ces enjeux, nous sommes entendus par les cadres. Nos idées passent, et elles passent plutôt bien. Reste que leur mobilisation ne se traduit pas par la grève ou par une action classique. Elle va emprunter la forme d’une opposition dans une conférence budgétaire, avec arguments à la clé. C’est un « pouvoir d’influence » qui se manifeste dans un cadre professionnel plus que revendicatif.
Dans cet ordre d’idées, notre Ufict a élaboré un Manuel de survie au management, et nous avons créé un cycle de formation au contre-management, suivi par une trentaine de cadres, ce qui permet de débattre des fiches théoriques mais, surtout, des réalités, des difficultés quotidiennes. C’est concret, ça part du travail et ça crée des liens. C’est vital face à une loi qui ambitionne de démanteler les capacités de résistance collective, notamment en annulant les résultats des élections professionnelles et en balayant les acquis qu’ils impliquent. La fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est du même ordre : elle va entraîner la suppression massive d’instances et, de fait, renforcer le modèle autoritaire de management.
– Thomas Deregnaucourt : Nous allons devoir affronter des moyens de coercition renforcée : précarisation, variabilité et, surtout, changement de philosophie : c’est qu’il ne s’agit plus, désormais, d’avoir des fonctionnaires loyaux mais des fonctionnaires soumis au politique. Le message, c’est de respecter les consignes du chef, et d’apprendre à se taire. Face à quoi, il faut radicaliser notre discours, ne laisser passer aucune des attaques portées aux garanties statutaires, dénoncer leur caractère toxique pour l’intérêt général et public. Les passe-droits, les nominations de copinages, doivent être dénoncés, et nous devons leur opposer les caractéristiques du statut qui, contre l’impartialité, le népotisme, la corruption, garantissent la neutralité, l’impartialité, l’égalité…
Il nous revient de réagir à l’endoctrinement, à tout enrôlement autoritaire de nos collègues. Il est possible de réagir en créant des temps d’échanges afin de rompre l’isolement de chacun. Il nous faut recréer des espaces de dialogue entre métiers, sachant que les identités professionnelles sont les lieux du bien faire. Parce qu’elle défend le travail, la Cgt ne peut s’en désintéresser.