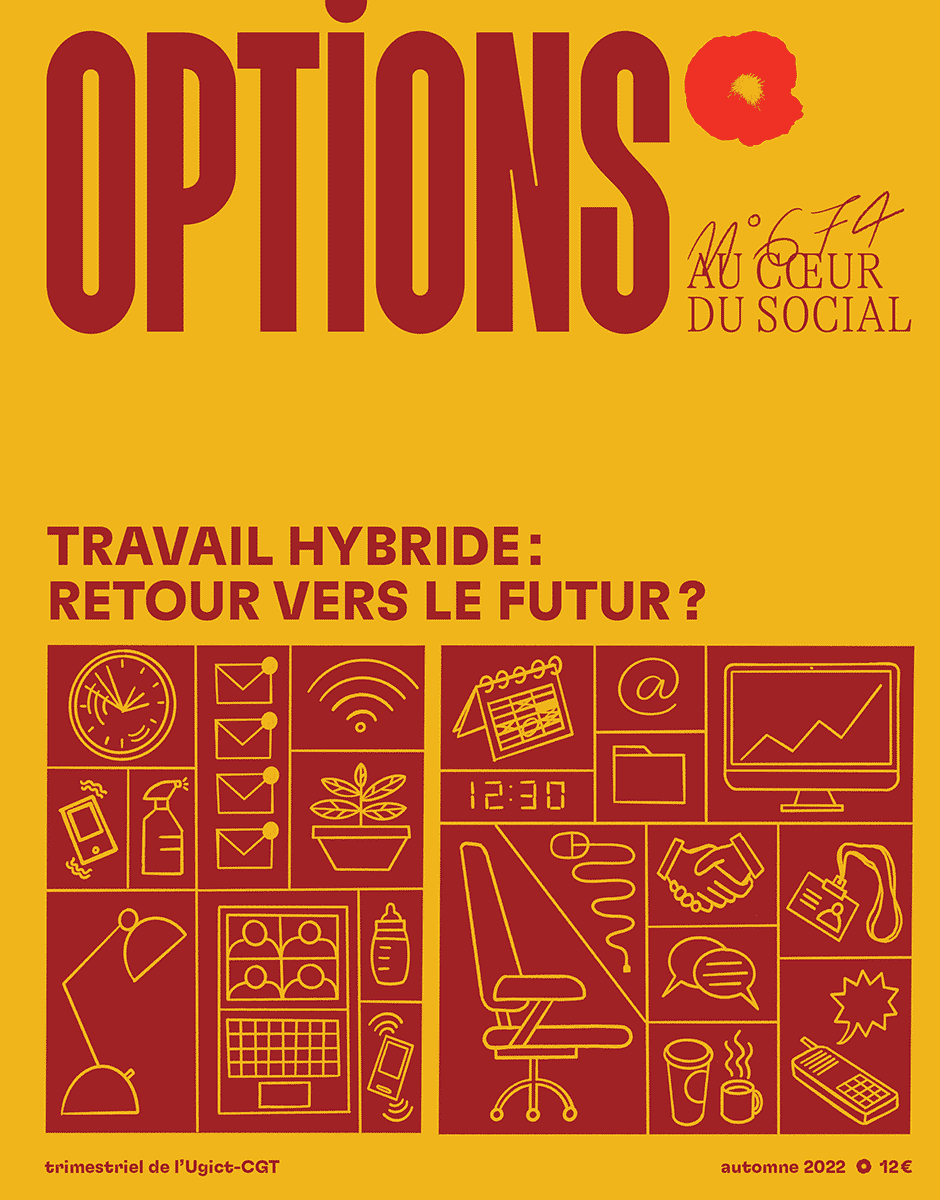Table ronde – Lanceur d’alerte : acteur isolé, acteur collectif…
20 novembre 2019Participants : Alexandre Berthelot, ex-directeur général de Haemonetics France ; Sophie Binet, cosecrétaire générale de l’Ugict-Cgt ; Guylain Cabantous, délégué […]
Participants :
- Alexandre Berthelot, ex-directeur général de Haemonetics France ;
- Sophie Binet, cosecrétaire générale de l’Ugict-Cgt ;
- Guylain Cabantous, délégué syndical central Cgt de l’Établissement français du sang ;
- Emmanuel Vire, secrétaire général du Snj-Cgt ;
- Pierre Tartakowsky, Options.
– Options : en dévoilant des dysfonctionnements chez Haemonetics France, son directeur général, Alexandre Berthelot devient lanceur d’alerte. Quelles en ont été les conséquences ?
– Alexandre Berthelot : Je suis devenu lanceur d’alerte à mon corps défendant, pour avoir fait mon travail. J’avais constaté des pratiques dysfonctionnelles graves, allant du simple problème commercial au trafic de pièces de récupération vendues pour neuves. Plus grave : des joints réalisés dans un carbone réputé biocompatible mais, en réalité, contenant des composés mutagènes qui libéraient des particules cancérigènes dans le sang. Il y avait donc mise en danger des patients, de l’entreprise, de ses salariés. Comme mandataire social, je me devais d’intervenir. Mais la direction avait une tout autre opinion. Pour donner l’alarme, je m’appuyais sur un dossier, des preuves et des obligations légales. J’étais persuadé que la direction mondiale serait à l’écoute, en attente de solutions. Au lieu de quoi, j’ai essuyé une vague de violence, assortie de menaces de mort !
Comme cadre, j’avais accès à 70 % des dossiers de l’entreprise, je pensais avoir les leviers en mains : le choc a été rude. J’ai tenu six mois avant de comprendre que j’étais sans pouvoir ; six mois terribles, marqués par des agressions personnelles. Le président Europe, un Américain, m’a qualifié pêle-mêle de sale Arabe fainéant, de renégat à ma caste, de sale communiste et jugé que je méritais la mort… Après avoir démissionné de mon mandat de dirigeant, j’ai été licencié de ma position de directeur commercial Europe. Je me suis alors engagé dans le « cascading d’alerte » prévu par la loi : les autorités sanitaires, le ministère de la Santé, le ministre, etc. C’est à ce moment-là que mon avocat m’a appris que j’étais devenu légalement lanceur d’alerte. Heureusement, car si ça n’avait pas été le cas, j’aurais connu bien pire.
– Guylain Cabantous : L’alerte d’Alexandre est venue conforter un processus d’enquête entamé au sein de l’Établissement français du sang. On avait vu apparaître des particules noires dans le plasma. C’était visible et repéré par tous, mais personne ne disait quoi que ce soit. Pour les infirmières, le silence des médecins indiquait qu’il n’y avait rien de grave. Pour les médecins, comme la direction scientifique et médicale se taisait, il n’y avait pas de problème. Tout était donc normal. Moi, je relève des services techniques et j’assume des responsabilités syndicales, mais comme on ne me dit rien… Jusqu’au jour où je découvre l’affaire Haemonetics dans un article de Mediapart. J’interroge la direction, en tant que délégué du personnel, pour obtenir des informations et la retransmettre aux salariés, ce qui est très exactement mon mandat. J’obtiens un vague : « Vous n’avez pas le dossier, n’est-ce pas ? » Il y avait donc un dossier.
Grâce à la fédération Cgt de la Santé, j’entre alors en relation avec Alexandre, pour déterminer si nous devons avoir une position et une expression sur notre travail. Je m’appuie pour ça sur un panel d’outils légaux : délégués du personnel, Chsct, délégués d’entreprise, courriers. Face à quoi la direction déclenche une campagne d’affolement : l’entreprise va être ruinée, le marché mondial du plasma déstabilisé, les malades vont manquer de produits, les salariés vont perdre leur emploi. Bref, je deviens M. Catastrophe. Le tout sur un mode soft : on fait la sourde oreille à mes demandes ; en externe, on minimise ; en interne, on isole le trublion : un cégétiste, c’est tout dire… Je me retrouve alors très seul : sur les 8 500 salariés, pas un ne se range à mes côtés. Seuls deux autres syndicalistes font un geste : le premier, un cadre, tente la voie hiérarchique et l’autre pose des questions en comité d’entreprise Île-de-France. Mais c’est en dehors de l’entreprise, au sein de la fédération et dans l’interpro, singulièrement avec l’Ugict, que j’ai trouvé appui et secours. C’est cette solidarité militante qui m’a permis de tenir, qui a permis qu’on décide collectivement de la façon d’aborder ce dossier, auquel je me retrouvais intimement mêlé. Il me fallait du recul.

Guylain Cabantous 
Emmanuel Vire
– Sophie Binet : Dans toutes les affaires de ce type, l’articulation entre les individus et le collectif apparaît centrale. Ici, dans un cas, l’alerte débouche sur un licenciement. Dans l’autre, elle prend de l’ampleur et le lanceur est toujours dans l’entreprise, bien que la Cgt n’y soit pas majoritaire. C’est que le syndicalisme permet d’avoir des outils, des protections, un cadre collectif qui fait pièce à l’isolement. Il permet surtout d’échapper à la fausse alternative : se soumettre ou se démettre. C’est bien pourquoi l’Ugict réclame un droit d’alerte, de refus et d’alternative lié à la responsabilité professionnelle. Le statut des lanceurs d’alerte, pour nous, est une première pierre dans cette construction.
– Comment expliquer le mutisme généralisé dans les deux entreprises concernées ?
– Alexandre Berthelot : Lorsque le salarié « de base » voit le dirigeant de la boîte pour l’Europe de l’Ouest se faire massacrer, écraser comme une mouche, ça ne lui donne pas envie de bouger. Je pense d’ailleurs que c’est ce qui a motivé le traitement auquel j’ai eu droit : faire un exemple. De fait, seul mon directeur technique, Jean Philippe, m’a soutenu, comme délégué personnel cadre sans étiquette, parce que s’il avait eu le front d’en avoir une… C’est que l’entreprise est une petite structure commerciale, d’une quarantaine de salariés.
– Guylain Cabantous : L’élément décisif, c’est la culture d’entreprise : elle était propice à un tel scandale. Si l’on regarde la communication interne, tout va bien, tout est positif. C’est contradictoire avec la démarche qualité mais ça conforte une culture du résultat, du chiffre, de l’efficacité. Dans ce meilleur des mondes, le management est, lui, très strict : le moindre écart est durement sanctionné et ceux qui renâclent doivent partir. Cette injonction paradoxale à l’épanouissement et à l’obéissance tatillonne sidère, annihile toute velléité de réaction. D’autant plus lorsque l’administration qui surplombe l’établissement et qui peut prendre des initiatives vis-à-vis du droit, souvent sur injonction implicite du pouvoir politique, épouse l’argumentation de la direction. Après avoir étoffé notre dossier avec l’apport d’Alexandre et de Jean Philippe, nous avons voulu alerter la presse. À notre grande surprise, nous avons rencontré peu d’écho.
– Sophie Binet : on a travaillé ensemble là-dessus : le dossier était béton mais il restait un gros travail à faire. On s’est donc mis en recherche d’un journaliste d’investigation qui soit en mesure de vérifier, d’attester, de crédibiliser l’information, et de saisir l’opinion publique. Mais finalement, seuls Mediapart, Bastamag, L’Humanité, Le Média et la cellule d’investigation de Radio France, service public, s’en sont saisis.

Sophie Binet 
Alexandre Berthelot
– Emmanuel Vire : La liste est courte mais elle en dit long. Ces quatre titres sont indépendants des puissances financières, ils n’appartiennent pas à un milliardaire. On mesure là les effets d’une concentration toujours plus étroite entre quelques mains, et de la réduction drastique du nombre de journalistes. On le dit peu, mais il ne reste que 35 000 cartes de presse, en France, tous médias confondus et ce chiffre ne cesse de diminuer. France Télévision travaille à un plan de suppression de 1 000 emplois sur 9 500 ! Et à chaque fois, l’investigation écope en priorité, alors même qu’il y a une multiplication des affaires et une demande croissante de transparence dans le public. La bonne nouvelle, c’est qu’on voit poindre des résistances professionnelles, sous forme de coopération : les Panama Papers, la constitution d’un consortium international d’investigation, les implant files, avec 250 journalistes dans le monde travaillant sur le dossier. Autant de moyens, de méthodes pour réussir à « sortir » les sujets.
Reste que, pour beaucoup, les journalistes n’ont plus l’impression de faire leur métier, à la fois parce qu’ils sont peu nombreux, qu’ils subissent des cas de censure avérée, directe ou indirecte, quand il ne s’agit pas tout simplement d’autocensure, comme ça avait été le cas à Géo, en 2011. Il s’agissait d’un article traitant de la collaboration de Louis Vuitton sous l’Occupation. Pour mémoire, Géo est un magazine du groupe allemand Bertelsmann, et Lvmh est le premier annonceur publicitaire de la presse magazine. Nous avons rendu l’affaire publique, mais les groupes de presse restent plus que jamais mus par la logique publicitaire, au détriment de l’éthique professionnelle.
– Pourtant, les pouvoirs publics s’acharnent, de diverses façons, à limiter toujours plus la liberté d’expression…
– Emmanuel Vire : C’est que le désir d’information et le besoin de liberté d’expression s’expriment avec insistance, de façon récurrente. Avec Emmanuel Macron, un cap a été franchi. Le président de la République a décrété qu’un journaliste est, par essence, neutre. C’est absurde : un journaliste doit faire son travail correctement, enquêter, vérifier ses sources, mais il n’est pas – il ne peut pas être – neutre. Chaque journal définit sa ligne éditoriale, ses choix, ses modèles culturels particuliers. Bien que la candidature Macron ait été dans une large mesure fabriquée par ces médias, cela ne les rend pas suffisamment serviles aux yeux du pouvoir. D’où la stigmatisation des journalistes qui font leur métier – comme dans l’affaire Benalla ou des ventes d’armes à l’Arabie saoudite – et les arrière-pensées suspectes qu’on leur prête… Les médias se voient logés à l’enseigne des cadres ou des lanceurs d’alerte : sommés de ne soulever aucun problème. D’où une offensive législative, avec la loi sur le secret des affaires, la loi Avia sur les contenus haineux d’Internet et des pressions pour faire sauter le secret des sources avec les convocations de journalistes à la Dgsi. Du jamais-vu !
– Alexandre Berthelot : Cette mise sous pression est assez cohérente avec l’évolution des jeux de pouvoir dans le monde. Aujourd’hui, le monde des affaires prend en charge les affaires du monde, en direct, sans intermédiaire, sans avoir à se référer à un quelconque intérêt général. D’où une nouvelle race de dirigeants, très techniques, très compétents et dépourvus de tout état d’âme. Le candidat Macron a été activement soutenu par le groupe Blackrock, un champion du business. Haemonetics appartient majoritairement à Blackrock, qui investit beaucoup dans les médias. Lorsque j’ai commencé à discuter avec Guylain, j’ai retrouvé, terme à terme, la stratégie de harcèlement que j’ai eu à subir durant six mois. À croire que nous avions les mêmes dirigeants. De fait, lui affronte son ministère de tutelle, qui dépend d’Emmanuel Macron, lequel bénéficie de l’amitié du groupe Blackrock. Moi, j’ai eu affaire à Blackrock en direct. Pseudo-public ou privé, les dirigeants sont les mêmes. Avec son « entreprise France », Emmanuel Macron symbolise cette fusion concrète des intérêts publics et privés.
– Sophie Binet : Les lanceurs d’alerte sont bien le symptôme de la collusion généralisée et de la prise de pouvoir des multinationales sur le monde et la puissance publique. Cela fait des années que l’Ugict analyse la crise des cadres comme symptomatique du fait qu’ils ne sont plus associés aux orientations stratégiques de l’entreprise, arrêtées par les actionnaires. D’année en année, nos sondages le confirment : la transformation des entreprises en machines à cash inscrit les cadres en contradiction avec leur éthique professionnelle. Les lanceurs d’alerte ne sont donc que la partie émergée d’un problème plus vaste : la dépossession du contenu et de la finalité de notre travail. Cela s’accompagne d’un management basé sur un enrôlement des salariés, particulièrement des cadres, et d’une responsabilité sociale des entreprises ramenée, le plus souvent, à une éthique de papier glacé, sans aucune contrainte pour les employeurs.
Pour autant, cette stratégie bute sur l’esprit critique des salariés, sur l’élévation de leur niveau de qualification et sur l’accès direct, via Internet, à une multitude de sources d’information. Autant de leviers de résistance qui trouvent leurs points d’appui dans les contradictions des directions elles-mêmes. D’ailleurs, lorsqu’ils sont confrontés à la vindicte de leurs employeurs, la plupart des lanceurs d’alerte invoquent, non sans naïveté parfois, la charte éthique de l’entreprise pour dire qu’ils n’ont rien fait d’autre que d’en appliquer strictement les termes.
– Comment aller plus loin dans cette défense des libertés et de celles et ceux qui la font vivre ?
– Emmanuel Vire : Le premier objectif doit être de rompre l’isolement : dans le cadre légal actuel, le lanceur d’alerte salarié se retrouve seul. Comme le législateur n’a voulu associer ni les représentants du personnel, ni les organisations syndicales, il a organisé légalement l’isolement du salarié et, donc, sa précarisation. C’est un non-sens total qu’il nous faut dénoncer sans relâche, jusqu’à obtenir qu’il s’inverse en système protecteur, basé justement sur une articulation entre liberté individuelle et garanties collectives. Au-delà de telle ou telle affaire, l’enjeu est de permettre à chaque journaliste de bénéficier d’une capacité d’indépendance et d’investigation. La problématique est identique à celle des droits des cadres : il s’agit de leur ouvrir un droit de refus, d’alerte et d’alternative dans l’exercice de leur responsabilité professionnelle.
– Alexandre Berthelot : La question de l’isolement est en effet essentielle. La loi Sapin 2 aménage un premier statut pour les lanceurs d’alerte et adosse de façon positive la définition de l’alerte à « l’intérêt général » et pas seulement à la loi. Mais le circuit d’alerte qu’elle impose est très verrouillé, et le syndicat n’y est à aucun moment mentionné. Pire : si le salarié le saisit, cela devient une entorse à la procédure et peut se retourner contre lui. Ce système roule totalement pour l’entreprise mise en cause. Première prévenue de l’attaque, elle peut identifier le porteur d’alerte et a tout son temps pour le harceler, le stigmatiser, tout en organisant sa propre défense. Cela revient à s’autodénoncer : je révèle quelque chose que je ne devrais pas savoir et toi, mon employeur tu vas pouvoir me l’imputer à charge ! La grande avancée, ce serait de pouvoir alerter directement.
– Guylain Cabantous : Tout ne se joue pas d’abord au plan légal. En amont, nous devrions veiller à valoriser le quotidien et ces petites choses qui le constituent, comme elles constituent notre travail. Nous quatre, nous discutons en ce moment de quelque chose d’exceptionnel mais qui, en fait, ne relève pas de mon travail quotidien. Mon quotidien, ce sont les soucis des assistantes de vie dans des Ehpad, des assistantes téléphoniques, des gens à qui on dénie leurs droits… Tout ce qui fait la réalité de la société. Passer à côté de ces petites choses, c’est s’interdire de comprendre de quoi sont faites les grandes. Il faut trouver le moyen de réhabiliter ce qui est petit, discret, de mettre en lumière comment cela permet ou non des dysfonctionnements qui peuvent tourner à la catastrophe. Cette mise en valeur du travail, dans ses modes et ses finalités, est de notre responsabilité de syndicalistes.
– Sophie Binet : L’enjeu, c’est de gagner des droits sur le professionnalisme du quotidien. C’est parfaitement illustré avec l’accident Sncf qui a précipité le retrait massif des cheminots. Voilà deux inspecteurs du travail qui estiment, à partir de leur professionnalisme, que ce droit de retrait est légitime, interpellent l’entreprise sur les mesures envisagées dans le cadre du plan de sécurité, soulignent que la suppression des contrôleurs est entamée depuis des années mais qu’elle n’a pas été intégrée au plan de sécurité. Immédiatement, l’administration et la ministre de tutelle les désavouent publiquement !
Cela remet en cause l’exercice même du professionnalisme de chacun. Nous savons que 36 % des cadres ont été témoins de faits illégaux ou contraires à l’intérêt général dans leur travail et que 42 % d’entre eux disent qu’ils ne l’ont pas signalé. À la question posée sur les dispositifs d’alerte, 49 % déclarent qu’il n’y en a pas ou qu’ils ne les connaissent pas. Enfin, un sur deux estime réel le risque de représailles. Il y a de quoi faire ! Il s’agit donc, avec la transcription dans le droit français de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte, d’avancer vers un cadre collectif qui supprime l’obligation d’alerte interne avant l’alerte externe, qui permette au lanceur d’alerte d’être accompagné par un syndicat ou un facilitateur, et qui autorise le portage de l’alerte, singulièrement par le syndicat, ce qui protégera le salarié.
Je m’appuyais sur un dossier, des preuves et des obligations légales. Comme cadre, j’avais accès à 70 % des dossiers de l’entreprise, je pensais avoir les leviers en mains : le choc a été rude. J’ai tenu six mois avant de comprendre que j’étais sans pouvoir ; six mois terribles, marqués par des agressions personnelles.
Les médias se voient logés à la même enseigne : sommés de ne soulever aucun problème. D’où une offensive législative, avec la loi sur le secret des affaires, la loi Avia sur les contenus haineux d’Internet et des pressions pour faire sauter le secret des sources avec les convocations de journalistes à la Dgsi. Du jamais-vu !
À l’Ugict, Nous savons que 36 % des cadres ont été témoins de faits illégaux ou contraires à l’intérêt général dans leur travail et que 42 % d’entre eux disent qu’ils ne l’ont pas signalé. Sur les dispositifs d’alerte, 49 % déclarent qu’il n’y en a pas ou qu’ils ne les connaissent pas. Enfin, un sur deux estime réel le risque de représailles. Il y a de quoi faire !