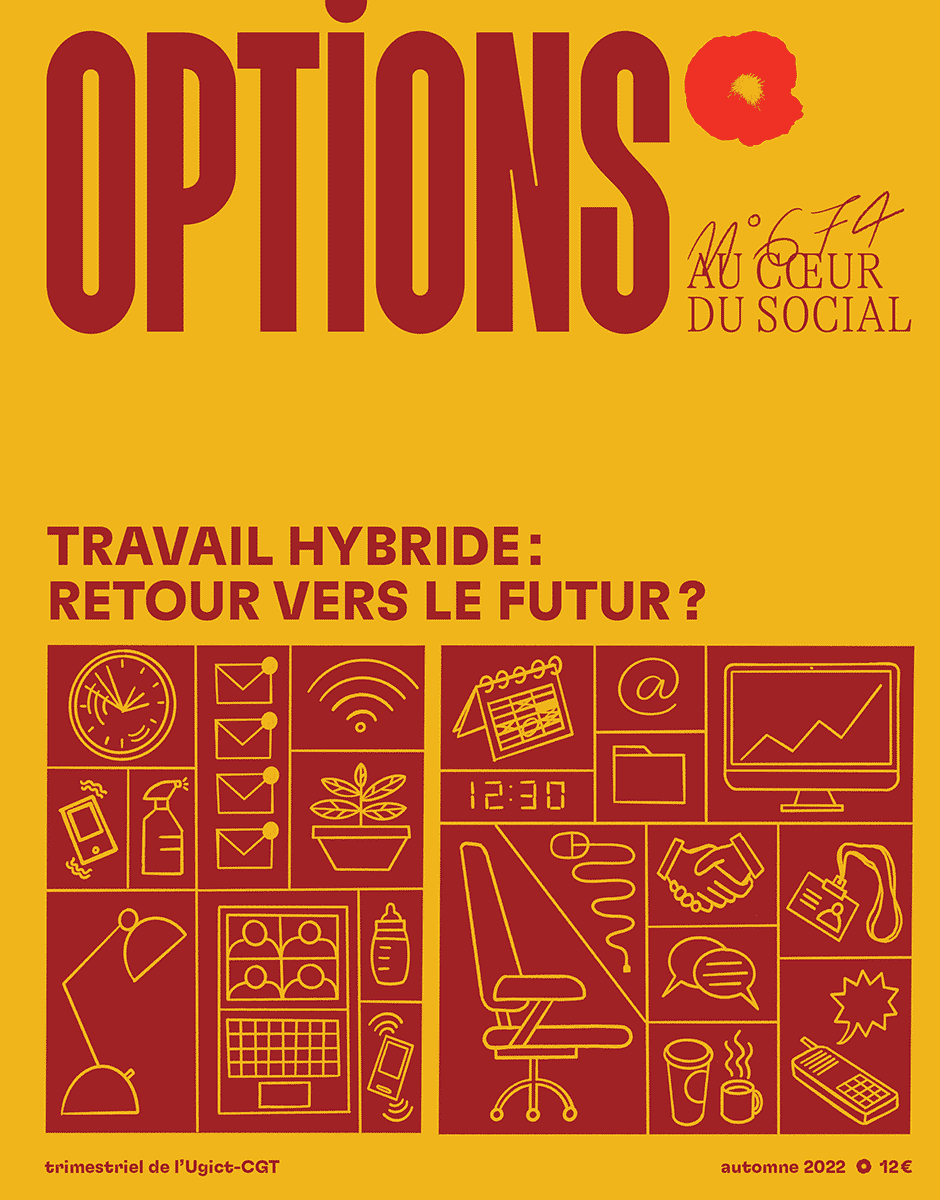Table ronde – Retraites 1995-2020 : d’un conflit l’autre
3 janvier 2020Participants : Guy Groux, Sociologue au Cevipof (Sciences Po), il a dirigé le livre Le Social et le Politique avec […]
Participants :
- Guy Groux, Sociologue au Cevipof (Sciences Po), il a dirigé le livre Le Social et le Politique avec Martial Foucault et Richard Robert (Cnrs Éditions, février 2020) ;
- Michel Margairaz, Professeur émérite d’Histoire économique contemporaine à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Dernier ouvrage paru, avec Danielle Tartakowsky : L’État détricoté. De la Résistance à la République en marche (Éditions du Détour, 2018) ;
- Jean-Marie Pernot, politologue, chercheur honoraire à l’Institut de recherches économiques et sociales, spécialiste du mouvement syndical.
- Pierre Tartakowsky, Options.
– Options : Quelles sont à vos yeux les principales singularités du mouvement en cours au regard des conflits passés ?
– Michel Margairaz : Le contexte de ce mouvement, c’est la stratégie de l’État. Il naît d’une réaction à une politique publique. C’est donc un mouvement défensif, comme la plupart des mouvements depuis 1995, qui vise à conserver des acquis, des droits remis en cause par l’État. Il porte une réalité interprofessionnelle, même si cette dimension est toujours difficile à évaluer, en quantité et en rythme. On note un élargissement, une base multiple et qui se diversifie, mais cette extension s’opère au moment ou d’autres secteurs commencent à marquer le pas. Pour mémoire, en 1936, le mouvement n’est pas très interprofessionnel ; les services publics fonctionnent. Celui de mai-juin 1968 l’est plus nettement, mais c’est une exception.
C’est également un mouvement qui procède d’un mixte social-sociétal, ce qui relève d’une évolution longue ; cela fait longtemps que le syndical a englobé des aspects du sociétal. Un élément nouveau, original, c’est que la mobilisation syndicale succède à celle des gilets jaunes, un mouvement aux formes complexes, qui a donné lieu à des contacts, à des rencontres mais pas à des conjonctions organiques, durables. Dans la phase présente, les formes de mobilisations multiples qui se croisent créent des attentes de relais, y compris dans les organisations syndicales.
– Guy Groux : C’est effectivement un mouvement défensif, comme ceux qui se développent dès le milieu des années 1970, marqués par l’essor du chômage, la disparition de filières industrielles et une certaine rétraction revendicative sur l’emploi, mais avec une différence cruciale : dans les années 1970, il y avait un projet politique alternatif à la droite, avec le programme commun de la gauche. Quoi qu’on pense de ce qu’il en est advenu, dans les têtes et dans les luttes cela faisait une différence. La droite et la gauche s’affrontaient autour d’enjeux économiques majeurs (niveau de production de l’acier, automobile…).
C’était concret, ça résonnait dans les luttes, ça les articulait à un débouché politique. Dans les années 1990, c’est fini. D’où une modification sensible du rapport à l’État. Aujourd’hui, quoi que fasse l’État – de droite ou de gauche – c’est suspect et cela implique des réactions de défiance et de défense. C’est vrai dans beaucoup de pays et plus encore en France où le rapport des syndicats à l’État a toujours été central.
La mobilisation syndicale succède à celle des gilets jaunes, un mouvement aux formes complexes qui a donné lieu à des contacts, à des rencontres mais pas à des conjonctions organiques, durables.
– Jean-Marie Pernot : Tout dépend de la période à laquelle « l’avant » se réfère. S’il s’agit de l’avant-décennie 1980, il va de soi que tout a changé, à commencer par le rôle de l’État. Face à un mouvement syndical assez puissant, à un patronat capable de passer des compromis et à un salariat composé de communautés de travail diversifiées mais organisées en grands statuts (secteur public et conventions collectives), l’intervention économique de l’État s’était doublée d’un rôle de grand ordonnateur du social.
Ça change dans les années 1980 – pas totalement, il faut se garder de catastrophisme, les argumentaires qui circulent en ce moment montrent que, même abîmé par les réformes depuis 1993, le système de retraites a tout de même permis de sortir de l’identification entre retraite et pauvreté. Mais depuis ce moment, le paradigme néolibéral s’impose et les interventions de l’État vont plutôt dans le sens du détricotage, ce qui explique cette méfiance à l’égard de la « réforme ». La réforme conservatrice est devenue synonyme de régression. Alors, les conflits sont devenus défensifs, c’est l’évidence, car l’initiative a changé de camp. C’est particulièrement marqué aujourd’hui, car l’initiative peut être violente.
– Michel Margairaz : Rapport à l’État, certes, mais qui se combine avec une toile de fond dramatique : l’emploi. À partir de 1977, la conflictualité marque le pas puis décline, en concomitance nette avec la croissance du chômage de masse. Revendiquer devient plus compliqué et, aussi, plus dangereux. Le conflit actuel s’inscrit dans cette histoire des politiques économiques de l’État. Il résulte d’une triple stratégie, amorcée de très longue date, mais dont les composantes se sont affirmées et conjuguées avec une visibilité toute particulière depuis l’accession d’Emmanuel Macron à la présidence : austérité budgétaire, austérité salariale et, enfin, amoindrissement de l’État social.
L’austérité budgétaire – qui remonte à 1982, sous Pierre Mauroy – est alimentée par la baisse des impôts, notamment ceux des plus nantis. Pour attirer les capitaux, financer l’économie et l’État, il faut réduire la dette afin de se crédibiliser sur les marchés. Le poste des dépenses sociales apparaît donc comme une charge insupportable. C’est le fameux « pognon de dingue ». L’austérité salariale, dans le public comme dans le privé, est littéralement devenue une variable d’ajustement, qualifié d’ailleurs de « dévaluation interne ». Comme il n’est plus possible, avec l’euro, de jouer sur la valeur de la monnaie, la « modération salariale » a pris le relais. C’est le discours d’Édouard Philippe sur le financement des retraites : pas question d’alourdir le « coût du travail » car cela handicaperait la compétitivité. D’où également les baisses de cotisations, les fameuses « charges », afin de faire passer la pilule.
Cette politique-là, elle date de Raymond Barre et elle a été confirmée au fil des gouvernements, cahin-caha. Enfin, et cela découle de ce qui précède, il y a l’amoindrissement de l’État social, privé de ressources par la suppression des cotisations, la baisse des dits « prélèvements obligatoires » – en fait les ressources de la redistribution fiscale et de la protection sociale. Dès lors, on bascule d’un système assurantiel, fondé en 1945, vers un système d’assistance, dans lequel les risques ne sont plus pris en charge par la société, mais par les individus, salariés et retraités.
– Un climat de forte adversité, un gouvernement inflexible sur le fond de son projet… L’ampleur de la réaction syndicale dans un tel contexte, le soutien dont elle bénéficie dans l’opinion publique, indiquent-ils une rupture salutaire dans le cours du fait syndical ?
– Jean-Marie Pernot : Si l’on se réfère à la période post-1995, c’est-à-dire le moment d’ouverture du grand cycle protestataire (1995, 2003, 2006, 2009, 2010…), il y a évidemment des changements. Pour autant, je ne suis pas sûr qu’ils traduisent un regain de puissance particulier des syndicats. D’abord le thème des retraites est lié à celui du travail, c’est-à-dire ce qui est le plus massivement vécu non seulement individuellement par chacun mais aussi au sein des familles. C’est ce qui fait lien entre générations, c’est ce qui fait « société » par excellence. Et là, le projet gouvernemental fait fort : le flou du projet et l’espèce d’amateurisme manipulateur dont il a fait preuve témoignent de son mépris profond pour les citoyens, sans même parler des syndicats ou de toute forme de représentation collective qui lui est extérieure.
Il y a là une réaction de la société au sens où Karl Polanyi décrivait les réflexes de défense de la société face au développement du marché autorégulateur. Les conflits autour des règles du travail (loi Travail 2016 et ordonnances 2017) ne pouvaient pas rassembler aussi largement car ça ne renvoyait pas à un réel vécu par les travailleurs. Le point de comparaison, c’est plutôt 2010, et je ne suis pas sûr que la mobilisation actuelle soit plus large, même si la grève des secteurs les plus engagés est effectivement plus longue.
Face à la crise des élites ou des institutions, on assiste à une rétraction des mobilisations, qu’il s’agisse du syndicalisme ou d’autres mouvements sociaux. D’une manière générale, le rapport au politique est ambigu. Il existe une crise du politique certes, mais dans le même temps, la plupart des mobilisations s’adressent à l’État soit pour la création de nouveaux droits, soit – et c’est souvent le cas des luttes syndicales – pour la défense de droits existants et acquis.
– Guy Groux : Un mouvement revendicatif, ou social, ne se résume pas aux motifs qu’il allègue. Si l’on en revient au mouvement de 1995, on remarque qu’il porte l’expression d’une réelle défiance à l’égard des « élites ». Cela vise par extension les institutions qui, de près ou de loin, renvoient à quelque chose du pouvoir institutionnel : l’entreprise, les médias, les partis politiques, voire les syndicats, tous se situant tout en bas de l’échelle de confiance. En parallèle, face à la crise des élites ou des institutions, on assiste à une rétraction des mobilisations, qu’il s’agisse du syndicalisme ou d’autres mouvements sociaux (femmes, genre, logement, immigrés…).
D’une manière générale, le rapport au politique est ambigu. Il existe une crise du politique certes, mais dans le même temps la plupart des mobilisations s’adressent à l’État soit pour la création de nouveaux droits, soit – et c’est souvent le cas des luttes syndicales – pour la défense de droits existants et acquis. Dans le passé, le mouvement syndical, ne se limitait pas aux seuls droits : il portait des revendications systémiques, telles la nationalisation de l’économie, une planification concertée…
Ce basculement procède d’une crise dont les caractéristiques majeures sont l’hémorragie des syndiqués et la décrue des mobilisations. Hier encore, le syndicalisme se définissait comme un syndicalisme de classe et/ou de masse, aujourd’hui il est de fait réduit à sa fonction institutionnelle. Dans l’entreprise, le dialogue social est perçu par beaucoup de salariés comme une sorte d’entre soi associant la direction et les élus. D’où un contexte qui implique un syndicalisme de professionnels voire d’expertise ou, par réaction, un syndicalisme très idéologique, crispé, purement contestataire. Deux cas de figure insatisfaisants qui devraient encourager les organisations à revisiter le rapport qu’elles ont aux salariés.
– Jean-Marie Pernot : L’omniprésence de la figure de l’État est bien réelle pour deux raisons : la première est ancienne, elle tient à un patronat incapable de compromis, soit qu’il ne cède rien, soit qu’il récupère par le politique le peu qu’il concède. La deuxième raison est celle de l’offensive néolibérale qui, dans la plupart des pays capitalistes, a vu l’État intervenir fortement pour remodeler les relations professionnelles et rabaisser l’État social. Depuis la loi Travail et même depuis 2013, les gouvernements ne cessent de redéfinir à la baisse les conditions d’exercice de l’activité syndicale quotidienne, tandis que les employeurs continuent de dissoudre l’entreprise dans l’espace. Les syndicats ne résoudront pas ces difficultés dans une opposition aussi forte entre eux, mais au prix d’un effort commun, ce qui suppose quelques aménagements idéologiques de part et d’autre.
Il y a eu de sérieuses autonomies des bases syndicales par rapport aux structures. Cette distance vient de loin. Il y a une dimension structurelle de l’affaiblissement syndical liée à la division radicale entre les deux plus importantes organisations du pays. Tant que ce préalable n’est pas levé, les chances de reconstitution d’une puissance d’agir propre au syndicalisme resteront insuffisantes.
– Michel Margairaz : Je ne serai pas aussi pessimiste que Guy. Les mobilisations sont rarement intervenues, dans le passé, sur des questions structurelles, qu’il s’agisse de désindustrialisation, de pertes de compétences… Les dirigeants en parlaient certes, mais les actions étaient rares. De nouvelles formes émergent entre la population et le syndicalisme, qui reste une force. N’est-on pas en train d’assister, de fait, à une mutation du syndicalisme ? Il y a encore peu de temps, il était mort et enterré par nombre de spécialistes des sciences sociales. Aujourd’hui, il compte, il pèse et il anime, au-delà de sa seule sphère organisée.
Le conflit actuel ouvre un champ de questions : le syndicalisme n’est-il pas en train de devenir, de fait, le représentant d’une opinion dispersée, désindustrialisée, minée par le chômage, la peur d’être syndiqué ? En 1995, on a beaucoup parlé de grève par procuration. Là, c’est plus que de la procuration : c’est de la représentation. Les syndicalistes ne sont-ils pas en train de devenir des représentants de la société ? De muter en syndicalisme d’opinion, représentant tous ceux qui pensent « non » sans toujours pouvoir le dire, en n’ayant que rarement les moyens de l’exprimer sur leur lieu de travail, et plus rarement encore la possibilité de le faire vivre sur un mode organisé ? Dans un contexte déficitaire en termes de projet politique, ce processus peut sembler tentant, légitime. Il serait toutefois risqué, puisqu’il toucherait à la nature même du syndicalisme, en déplaçant son centre de gravité. C’est un peu ce qui se produit aujourd’hui. Est-ce un modèle, ça ?
– Jean-Marie Pernot : Eh bien moi, je serai moins optimiste que Michel. Je demande à voir, sur la notion de retour en force des syndicats. Il y a beaucoup d’éléments intéressants dans le conflit et des ressources potentielles pour les syndicats, mais je ne crois guère à l’idée d’une résorption substantielle de la distance entre syndicats et travailleurs. Les syndicats ont toujours un savoir-faire revendicatif et manifestant utile et respecté dans ce genre de moments, mais le mouvement comporte une bonne part d’autonomie à leur égard. D’ailleurs – et c’est un effet du mouvement des gilets jaunes –, il y a eu de sérieuses autonomies des bases syndicales par rapport aux structures. Cette distance ne s’effacera pas comme ça, car elle vient de loin.
Là où je rejoins pleinement Guy, c’est sur la dimension structurelle de l’affaiblissement syndical que constitue cette division radicale entre les deux plus importantes organisations du pays. Tant que ce préalable n’est pas levé, les chances de reconstitution d’une puissance d’agir propre au syndicalisme resteront insuffisantes. Ce qui n’empêchera pas nécessairement que, lorsqu’ils le jugent nécessaires, les travailleuses et les travailleurs, les citoyens et les citoyennes prennent la rue comme ils l’ont fait là. Et, avant que le syndicalisme paraisse porteur du devenir social, c’est-à-dire occupe pleinement la fonction politique à laquelle les invite Michel et, avant lui, la Charte d’Amiens, il faudra que soit reconnue sa capacité à s’acquitter de la première besogne, ce qui nous renvoie aussi à la division syndicale.